
- •Il est parti ce matin, n’emportant que quelques livres dans un gros sac mou. Il descendait l’escalier tordu.
- •Il ne m’etonnera jamais, il est fige dans ses murs. Seule la nuit ramollit les espaces, mais je n’aime pas la nuit, et je dors.
- •Il connait des histoires d'une autre
- •Il doit certainement y avoir un sens а tout cela. J’essaie de coller les morceaux ensemble, je ne trouve pas l’ordre, il n’y en a pas, ca vient comme ca veut. Et ca reste.
Il doit certainement y avoir un sens а tout cela. J’essaie de coller les morceaux ensemble, je ne trouve pas l’ordre, il n’y en a pas, ca vient comme ca veut. Et ca reste.
J'ai fait un reve : je suis dans un theatre repeint dans des couleurs pastel. Il y a des oiseaux bleus, des rosiers grimpants et des soleils pales. Ce vieux theatre autrefois poussiereux et sale devient elegant. On peut y circuler facilement. Des gens jeunes, assis dans les coins, fument des cigarettes. Je deambule, ne sachant pas tres bien ou je me trouve. Trop d’espace pour moi, trop de vide. Ils se preparent tous а quelque chose, il me semble que c’est une piece indefinissable — mais je sais qu’elle porte un titre serieux et qu’elle est d’un auteur d’un autre siecle. Et puis les choses se brouillent. J’enfile le mauvais costume — il est sombre — et j’ai а la main un script different des autres. Je suis venue jouer une autre piece. Tout le monde m’en veut de m’etre trompee. Et je ne peux plus me dedire, j’ai signe le contrat. Je dois faire semblant, jouer le role de la pute, elle aussi repeinte en pastel, au milieu d’une troupe d’acteurs rigolards qui font claquer les portes et grimacent comme dans les pieces de Fey- deau. La clarte du theatre, sa proprete ne me laissent pas la possibilite de me retrancher. Tout cela semble si facile et si normal. Je me suis trompee, je suis la seule а le savoir et а savoir que j’ai raison. Je me meurs.
Je sens que tout entiere je me trompe. Ce qui fut n'est que le deroulement logique d’une vie dejа engagee par d’autres, aux-quels j’appartiens encore. C’est lа que je suis nee; c’est cela que j’ai vu, entendu; c’est comme cela que l’on dit, que l’on fait, chez les gens de chez moi, et c’est ainsi, une vie comme une autre. Maintenant je choisis, j’opte, rien ne m’y oblige. C’est la faute de personne, ce ne peut etre que la mienne. Et si je me trompe, quel sera le chatiment? Si je me trompe, parce que j’ai fait semblant d’etre une autre, mais que je me devoile, que je denonce la tricherie en revenant, juste le temps d’une seconde, d’une inattention, а mon moi le plus profond?
Le crime etait presque parfait, puis juste une trace, et tout est perdu: je meurs parce que je me suis trompee.Finalement, je reste а la maison, ne calculant plus le temps, le laissant venir а moi, а sa facon. Je lis, je fume des cigarettes, il m’arrive meme d’oublier de vider les cendriers sales, cultivant mon complexe de fumeuse coupable. Et l’apres- midi s'endort, comme les chiens allonges pres de moi. Arrivent bientot neuf heures. Le plus jeune, blond et ebouriffe, vient tapoter de son museau le haut de ma cuisse, glissant sa tete sous le bras du fauteuil, reclamant par lа meme un calin de la main. Le petit gros ronfle, tout noir, tout rond, son pelage lisse comme une toile de caoutchouc mouillee, et attend qu’on le demande. Je l’appelle un peu fort pour qu’il entende — il est legerement sourd. Nous traversons ensemble la rue, celle ou passent le plus de voitures, pour rejoindre
la rue pietonne d 'en face et nous balader sans soucis, regardant par les fenetres, а hauteur de nez, la vie des gens. C’est une rue silencieuse, ou Racine est mort. Elle est longue, etroite comme un chemin, et je ne l’ai jamais vue comme ce soir, si longue, longue d’un calme entier. C’est le printemps dans la rue des chiens.
Des chiens attaches tirent sur leurs laisses pour reveiller leurs maitres distraits qui marchent doucement. Une femme courte sur ses jambes, avec un grand type plus jeune а cote d’elle, passe devant moi. J’entends le son desagreable de ses chaussures а talons qui crissent sur le pave cire, jusqu’au bout de la rue, j’entends son pas vulgaire et son discours inutile au grand type а cote d’elle.
J’aime penser en marchant, et j'aime aussi marcher. En me promenant, je laisse aller librement mon esprit. Les chiens aussi sont libres. Dans leur temps compte, ils se promenent а plein temps, reperent les lieux, font des petits tours, aller-retour, organisent leur monde de chiens. Ils ont des manies, ils se repetent comme si c’etait toujours la premiere fois. Je les aime bien,
leur confiance me flatte, je les flatte а mon tour et nous rentrons.
Chaque nouveau jour fait croire que le printemps est arrive. La peau durcie de l’hiver disparait peu а peu. Les magasins sentent la cire, un grand magnolia rose exhale un parfum de fleurs tiedies par le vent du soir. En face une rue remonte, ou s'engouffre le vent, laissant sur son passage des boules de senteur sucrees. J’ai mis le nez dedans et ferme les yeux.
Il fait nuit vite. Bientot arrivera le moment ou l’on sait qu’il n’y a plus rien а faire, que le temps lui-meme est epuise, qu’il ferme les yeux comme s’eteignent les lumieres. Il faut quitter cette journee.
Pourtant c’est une journee qui comptera, comme l’ombre peinte sous un oeil qui marque de sa presence une histoire. Celle du peintre ou du dessin ?
Chaque jour le silence se faisait plus epais, fermait pesamment les bouches et nous obligeait а se taire. A vivre en se frolant, а oublier que nous avions ete vivants et lourds. A nous mouvoir dans les vapeurs abstraites d’une autre realite qui, elle,
savait se defendre avec les mots qui bien sur mentent lа ou le mensonge est regle absolue.
Jeu de l’intelligence ou le nombre de probabilites augmente а chaque phrase, а chaque mot, multiplication gigantesque, infinie, de combinaisons. Vivance dangereuse ou le spectre de l’imaginaire se dedouble, confondant l’homme et le heros, unique duo, va-et-vient trouble entre le Je et le II. Avec pour seule echappee la transe alcoolique du sorcier qui devient le malade du malade, puis le guerrier et le fou, et qui danse le miracle de la guerison, les pieds sur la braise, la tete enivree. Monde virtuel ou les images de l’esprit sont infiniment folles et insaisissables.
Courir apres l’impossible, attire par les demons de l’intelligence seductrice qui ne se laisse jamais attraper. Juste quelques cheveux blonds restent accroches aux doigts, aussitot tisses, lettre apres lettre, pattes-de-mouche entrelacees, nouees si petitement qu’il en faut des milliards pour apercevoir un dessin, aussi delicat qu’une gaze peinte aux couleurs de la chair.
Monde de l’illusion ou l’on ne fait plus semblant. Mais l’illusion n’appartient qu’а celui qui l'a creee. Elle sacrifie le monde des vivants qui se meurt dans sa lente accumulation des jours et des nuits, des jours et des nuits. Elle s’immisce dans nos reves de vivants et s'agrippe а la peau de notre visage qu’on ne regarde plus dans le miroir, reflet superficiel pour ceux qui ne croient que ce qu’ils voient. Elle est toujours belle et nous fait croire que nous sommes eternels. Qui a invente cette illusion, Dieu ou le Diable? Devons-nous mourir, et faire mourir, pour les anges de l’irreel ?
Nous ne nous regardions plus. Je me detournais de son regard dissous.F
![]()
C'est ailleurs que je regardais, autour, dehors, quand je traversais les jardins du Palais-Royal et depassais les enfants dans les bacs, les parents assis les pieds dans le sable, les vieilles ratatinees qui tremblent dans leurs chaussures trop grandes et les solitaires en bleu marine. Ils marchaient tous vers moi, je les affrontais, marchant dans le soleil, le nez colle dessus. Mon grand manteau me donnait de l’assurance, et mes cheveux chatains s'enduisaient d'huile doree.
C'aurait pu etre le plus beau moment de ma vie, il faisait beau, et de surcroit j'etais jolie ce jour-lа. Mais je ne jouerais jamais а la Comedie-Francaise: j'avais refuse le role d'Amelie. Souvent, on me proposait des roles d'idiote, de cocotte idiote ou de cocotte tout court, mais je ne m'y sentai
spas bien. J'avais trop de compassion pour mes personnages. J’etais faite pour mourir d’amour, pas pour me moquer de l’amour. Encore un metteur en scene, un homme donc, qui ne savait pas que j’aurais pu mourir comme Juliette, comme Eurydice, que l’actrice que j’etais pouvait redevenir enfant, neant, concentre d’amour, plus fort et plus courageux que la jeune femme que j'etais.
Je prenais soin de mes roles, pas de ma vie. Comme une chaussette retournee, j’etais une femme а l’envers. Quand, le soir, je deshabillais la femme honnete, je revetais mon sac de contradictions, je me glissais dans le mensonge, j’enfilais mon vieux jean, celui dans lequel je me sentais le mieux.
Je ne croyais plus qu'il fallait continuer а s'inventer aussi des regles dans la vraie vie, la mienne, qui d’ailleurs ne l’etait plus mais etait devenue celle des autres. Pourquoi un jour m’avait-elle echappe ? J’avais laisse tomber le fil de mon histoire. Et je n’avais plus d’illusions. «Comment se peut-il que tout change tout а coup, qu’on
se perde dans son corps entre force et faiblesse ? » se demandait Valery.
Je remontais la rue de Rivoli, les jardins des Tuileries glissant sur ma gauche. Le temps se couvrait et revelait Paris, ville des amoureux, ce jour-lа terrible et vieille. Les arbres apercus entre chaque pic de fer forge des grilles du jardin se decoupaient а la verticale et se multipliaient en une foret oaleidoscope. Le ciel coulait comme une aquarelle peinte par un jour de pluie. Les couleurs du tableau fondaient et delavaient les troncs des arbres qui, de noirs et dores l’ete, passaient au bleu canard comme les huiles de petrole suintantes, formant des ronds verts et jaunes sur le macadam, dans des combinaisons contradictoires de couleurs. Les nuages se confondaient dans des gris indicibles tandis que la terre, griffee par les lames de pluie, degorgeait ses pigments naturels de terre de Sienne, rigolant des jaunes safran et tachant les pieds et les pierres de sang eclabousse. Les gens de la rue se pliaient comme pour s’essorer. Les femmes, genoux а decouvert, marchaient comme des geishas, bras
croises sur la poitrine, retenant leurs cotes, la tete baissee, а pas courts et rapides. Leurs chevilles, prises dans des bas nylon et piquees par la pluie, grattaient autant qu’une branche d'ortie frottee а meme l'epiderme. Les cheveux collaient, retenus par des mains huilees et maladroites.
Le spectacle etait commun, je connaissais cette rue, je ne connaissais pas ces gens mais c'etait comme si. Souvent je revois des gens dejа vus, et je les reconnais aussitot. Paris c’est pareil. Ainsi que les saisons.
La place de la Concorde etait encombree; j'avais le choix entre prendre les quais pour aller plus vite, ou l’avenue des Champs-Elysees pour voir les cinemas. J’avais rendez-vous avec un metteur en scene, en bas de l’avenue George-V, dans une brasserie, а une heure. Je choisis l’avenue pour regarder les affiches, et les figures sur les affiches. Je ne reconnaissais personne, ce n’etait jamais la meme chose d’une semaine а l’autre. La salete de l’avenue me decevait: la gueule aguichante des cinemas, les galeries obscures, scintillantes de strass, ou les danseuses du
Lido vous invitaient а entrer, pour voir, et d’ou on ne ressortait jamais, les fausses brioches dorees, les fausses chaussures dorees, les reverberes en acier tout neufs et les nouveaux trottoirs beiges commandes par la Mairie de Paris.
Ailleurs, ils rasent, expulsent, saisissent, construisent des bureaux qui resteront vides pour ceux qui ont dejа un sort. Il faut etre riche а Paris et habiter les beaux quartiers. Les coquilles des oiosques а journaux placardent les memes slogans et les memes gens, ceux qui ont reussi. Ils sont photographies devant leur propriete, avec leur maitresse, leur chien, leurs bijoux, leur voiture, leur sourire de porcelaine. Ils n’ont plus d’age, ils ont de l’argent.
J’etais fatiguee de ces moins de deux heures passees face а ce metteur en scene. Enfin son cafe arrivait. Pour accelerer la venue de l’addition, j’inventai un rendez-vous а l’autre bout de Paris, concluant avec beaucoup trop d’energie soudaine et de gratitude cet entretien epuisant. J’accumulai les mots dans un dernier effort lie а l'espoir d’en finir au plus tot, mais je sentis la discussion repar-
tir. Il prenait le chocolat pose sur la soucoupe du cafe et me l'offrait. Le ton changeait de style, devenait aussi sucre que le chocolat. Je le voyais, mielleux, vaniteux — et bete. Il avait des mots plein la bouche, il essayait de me seduire. Sa main qui tournait le cafe pendant qu'il me regardait etait petite et mechante, elle gluait sur la petite cuillere. Je me dis que c’etait un grand malade, qui suait tout le temps. Je reposai ma tete sur ma main, deformant ma bouche dans une moue d'ennui melee d'abandon; je m’amusai, avec le bout de mes doigts, а effleurer le duvet de mes cils, creusant ma main, evaluant au passage la rondeur de ma joue.
Puis je le regardai droit. J'evitai de courber le dos, cela aurait pu lui apparaitre comme une marque de relachement alors que je n'avais eu de cesse, durant ce repas, d'essayer de lui faire comprendre que je le percais а jour. Que j'avais dejа compris son film, sa vie, s'il baisait ou pas, s’il etait bon ou mechant. Je savais que je ne ferais pas son film. Pour quelles raisons sentimentales, intellectuelles, humaines l'au- rais-je fait? Je voulais vivre chaque nuit, chaque jour, une annee entiere, une vie entiere dans l'enthousiasme, c’est-а-dire habitee par Dieu, priant pour qu'il ne me lache pas. Quelles etaient ses motivations, а lui ? Son script etait nul parce qu'il etait nul, il ne pouvait en etre autrement, mais il ne le savait evidemment pas. Enfin cela se terminait, je revenais du marche au betail ou il avait fallu que je m’expose. J'etais humiliee. Je n'avais pourtant rien fait d'autre que l'ecouter, il n’avait pas cherche а savoir qui j'etais, cela ne l'interessait pas. Son dernier regard fut le pire de tous. Une mayonnaise de pretention et de simplicite huileuse, comme cet au revoir adresse par-dessus sa tete d’un geste plie, en agitant sa petite main mechante. Il se tordait en marchant, les epaules roulees vers l’avant sous son manteau de chameau noir. Meme de loin, ses chaussures avaient quelque chose de vicieux.
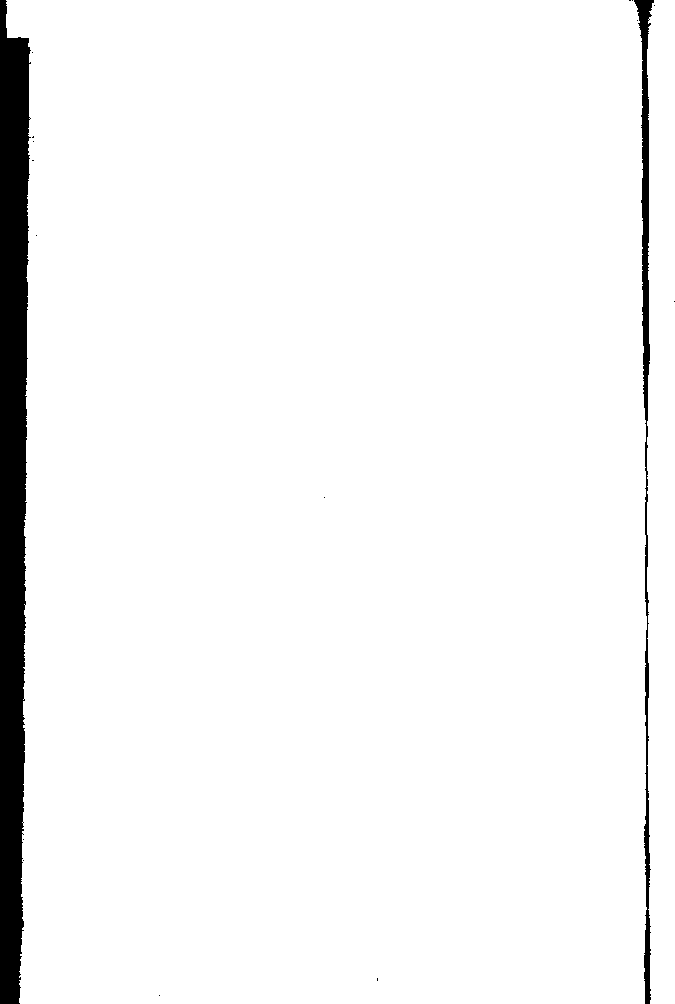
D’abord la lumiere, les mains blanchies qui crient dans le silence, les mots qui s’elancent, un rale qui gemit а la vie, а la mort. J'humecte les bouches, je bondis dans les ventres, je derange. Puis, sous la pluie du ciel brode de rouge, l’immensite se fait l’echo du vide. «Le reste est silence», dit Hamlet en mourant. Je voudrais jouer jusqu’au jour de ma mort. Le rideau tombe.
Ma loge est moite, comme la vie. Les lumieres s’eteignent les unes apres les autres. Les costumes baillent sans grace, ils ont l’air de pendus dans la poussiere, les miroirs sont fatigues. Je sors de l’eau quelques fleurs qui mouillent mes vetements, mon visage demaquille me semble amaigri. Je vais la laisser dormir et fermer la porte sans bruit. Allongee sur le sofa,elle dort, dans son habit de reine blanche. Elle est belle dans sa paleur translucide. Son corps vibre encore, secoue comme les quatre feuilles d’un hologramme. Je distingue а peine le dessin de ses bras et de son cou, qui clignotent comme au loin les etoiles dans la mer noire. On dirait des frissons qui etincellent, des pepites de verre noyees dans du lait. Elle fut et elle sera demain, rien ne peut l’atteindre. Elle a souffert, mais ses levres sourient encore un peu.
Je lache la poignee de la porte, je m’echappe dans la nuit. Une casquette sur la tete, je m’enfuis. Je devrais pleurer de ne plus rien avoir а moi, de repartir les mains vides, le coeur aussi. Je file droit sans regarder, je traverse la scene du cote cour au cote jardin, ce n'est plus qu’un point final, toute matiere est aspiree — et j’en etouffe. La fraicheur de la rue me detend, j’ai envie de rester dehors. Il fait nuit bleue, nuit claire, des gens attendent pour demander des autographes, je m’eclipse sous ma casquette, je les evite.
Je jouais mal. Il me l’a dit dans le restaurant italien а cote du theatre. Les tables а peine dressees satinaient de blanc leur dos sucre, les verres petits et grands scintillaient et les couverts d’argent reluisaient dans le restaurant vide. Quand nous rentrions, rougis par le froid dans cette pale chaleur, c'est а cette table que nous nous asseyions, entre la terrasse fermee et l'interieur plus confine de la salle, entre la nuit du dehors — la nuit de minuit qui m’etait devenue si familiere que je ne la remarquais plus, et l’eclairage artificiel du decor.
Je m’etais assise en silence, le dos lourd, les mains froides. J’attendais qu’il parle. Lui etait chaud, sa chemise etait froissee, il baissait les yeux, il cherchait а comprendre et me laissait en suspens. J’aurais voulu entendre des cloches se cogner, j’aurais voulu pousser un cri, un hurlement, me dechirer les bras, les mordre et arracher la chair, j’aurais voulu que ce soit terrible. J’imaginais le pire, j’esperais le pire. Qu’il se trompe, que la nuit devienne jour, que ce soit un autre jour dans un autre temps, le 14 decembre 1645 par exemple, qu’il ne soit pas lui, que je ne sois pas moi. J'etais prete а tout regretter pourvu que je sois excusable. Mais je ne l'etais pas.
Que s’etait-il passe? Il cherchait, ne comprenait pas qui j'etais devenue. J’avais beau tendre la main, l’appeler, il ne m’entendait plus, je n’etais plus lа. Il me dit que je jouais mal, qu’il ne comprenait pas pourquoi, et c’est parce que je ne voulais pas l’expliquer que je savais qu’il avait raison, que tout avait raison — sauf moi. Le visage bouffi d’avoir trop longtemps retenu la verite, la gorge seche, la peau du cou tendue et vieille et prete а craquer, j’etais blanche de honte et d’effroi devant ce qui pouvait m’arriver de pire : etre mauvaise. Je savais qu’il disait la verite et qu’il y avait une verite. Elle est terrible quand elle surgit ainsi, aussi lourde que la lame de la guillotine qui tranche, nette et precise.
Mes spaghettis resterent froids, l’assiette mouillee, la serviette mouillee, et toute mon ame trempee d’horreur. Tout ce qui me restait, tout ce qui etait а moi, а moi seule, meme cela je l’avais galvaude, abime.
Car tous les soirs, j’arrivais au theatre а six heures. Dans le bar desert qui s’ouvrait sur un balcon-terrasse abandonne depuis longtemps, un jeune homme silencieux etait assis dans la lumiere douce des fins d'apres-midi d’ete. Nous restions lа ensemble, le temps que les autres arrivent. On ne s’etait jamais donne rendez-vous, on ne se connaissait pas, mais il m’attendait et chaque soir j’arrivais en avance. J’essayais qu’il me trouve jolie. Je denudais mes bras et degageais ma nuque. J’aimais que mes cheveux s’emmelent gracieusement, laissant tomber quelques meches blondes ici et lа pour l’emouvoir. Parfois il s’asseyait, et venait lire а mon cote un journal quelconque, aplati sur la table carree. Coude а coude, nos bras ne se touchaient qu’а peine. Je n’imaginais rien de plus — cette proximite me suffisait, elle me remplissait d’une sueur froide — un baiser dans le cou, peut-etre. Le theatre vide nous protegeait, et le silence s’etouffait dans le velours. On se cachait derriere les fauteuils, on chuchotait, on etait bien, comme deux enfants tranquilles, le monde etait а nous. Jusqu’а ce qu’il devienne mon amant.
Il me raccompagnait jusqu’а ma loge aureolee d’une lumiere rappelant les bonbons acidules а l’orange. Je me preparais,me maquillais, me travestissais. J’avais dans une poche des batons de reglisse а moitie maches qui ressemblaient а des cheveux de sorciere. Dans l’autre, des pastilles de vitamines jaunes au fruit de la passion. J’etais prete, je partais arpenter la scene, dans mes godillots trop grands, rapes et fendus, alourdie par des couches empilees de jupes et de dentelles elimees qui trainaient en lambeaux. Tel un clown, je deambulais, revenant sur mes pas, faisant grincer sur le contreplaque du plancher les clous rouilles de mes chaussures. Il etait assis contre une colonne du decor, me regardait macher mon baton de reglisse, virevolter, faire la belle pour lui plaire. Le regisseur passait en diagonale sur ses basoets en gomme. Silencieusement, il descendait vers la console des commandes electriques de la scene; la bouche collee au micro, il disait bonsoir aux loges des etages superieurs, prevenait que le spectacle commencait dans une demi-heure. Certains acteurs n'etaient meme pas encore arrives; nous, nous etions dejа lа, dans le sas de notre demi- heure а nous.
Les jambes allongees droites devant
moi, les pieds en flexion, je m'etirais sur le sol dur pour detendre mon dos qui me faisait mal, et je roulais sur le sol, detendue dans mes linges froisses — je m'en fichais, mon costume devait etre sale. Je lui effleurais la jambe et me rasseyais. Lui n’avait pas bouge, il me regardait encore, les yeux aceres. Je sentais de nouveau son envie que quelque chose se passe. Du bout des doigts, dans la poche de mon gilet de laine, je tripotais les vitamines. J'avais envie d'en prendre une, juste pour faire quelque chose, pour en faire quelque chose, qu'il me voie la mettre dans ma bouche, que ses yeux entrent dans ma bouche. J'avais envie de manger cette vitamine, qu'elle fonde sur ma langue, que ma salive coule dans sa gorge. Ses yeux suivaient le mouvement et demandaient. Je lui tendais la moitie, le bonbon coince entre mes dents, mes levres autour attendant les siennes. Qu'il vienne casser sa moitie dans un baiser oblige et, poussant d'un petit coup de langue ce qui lui revenait, je touchais l'interieur de sa levre superieure et а partir de ce petit point de contact humide, mon corps tout entier se remplissait de miel.
L'effet se consumait comme un feu follet qui disparaissait aussitot, le gout de l'orange piquait et me reveillait, je rouvrais les yeux et je le voyais qui me regardait, sucant son morceau de medicament.
Je croisais les doigts devant mes yeux pour n'entrevoir qu’un petit bout de l’image. Zoom avant de la camera sur la jeune femme nue qui sort de son bain, et elle se metamorphose en vieille femme. Chair pendante, d'une maigreur indecente, sourire edente, elle s'agrippe а l'homme. Je cherchais la telecommande, appuyais sur stop et traversais l’appartement jusqu’а la chambre.
Comme soule, je traversais les pieces en suivant les lignes des murs encombres. Je ne me rendais compte de rien — j'ignorais, je meprisais l'insistance inquisitrice des meubles lourds incisant la nuit de poix. Je ne voulais ni les entendre ni leur rendre leur legitimite. Ils etaient lа parce que je le voulais bien, et qu’ils me servaient. Je n’allumais pas la lumiere, elle m’agacait, elle etait fausse, je preferais l’eteindre et me debrouiller seule sans ses conseils de petite fille trop sage, qui sait toujours comment se conduire.
Les objets me contredisaient, tentaient doucement ou violemment de me dire de me ressaisir, me sautaient а la gorge dans un dernier geste d'amour, deployaient leurs feux et leurs charmes pour me dire d'arreter, de ne pas aller plus loin. Je ne voulais pas les entendre. Je leur refusais la parole, je les croyais muets. Toutes ces fleurs, tous ces tableaux, ces fauteuils, ces vases, cette plante qui tombe la tete en bas le long du mur, ces tables maternelles qui pleurent а present, ce tapis ami qui glisse sous mes pieds — tous criaient, s’insurgeaient dans ce silence devenu insupportable. Je les sentais me grimper а la tete et а la gorge. Meme mon coeur devait prendre de grandes respirations, essayait de ramener le calme sans y parvenir. Il n’etait pas convaincu que j’aie raison et doucement il abandonnait, impuissant, decu aussi probablement. Je m’avancais vers la derniere piece amie, elle m’offrait largement son miroir et renvoyait mon image enorme et lisse, humaine. Alors tous se taisaient, ils avaient vu. Leurs chuchotements de bois,
leurs epaules sculptees, leurs pieds de verre n'avaient plus rien а dire. Nue, je regardais le miroir et je ne voyais rien non plus, rien d’autre que des lignes douces, innocentes, la cape d’une epaule, le «S» d'une hanche, le rond d’un sein petit comme un jouet. Rien n’etait sale lа, tout etait simple et sans histoire.
Ce n’etait pas comme ils croyaient.
Je m'entends respirer, la figure mouillee, trempee de morve et de larmes. Ma respiration est saccadee, comme celle d’un chien qui a trop chaud. Le corps tout entier soumis а l’etouffement, il ne me reste plus que quelques minutes а vivre et pourtant je suis eveillee, consciente. Je vois l’oreiller grossi par l’eau des larmes qui fait loupe, et je ne peux plus bouger. Je suis allongee, nue et dure comme du bois. Il faut que cela sorte mais ni les sanglots ni les cris ne suffisent, le mal est trop gros, si lent а se mouvoir. Cela m'etire et me lance, je me crispe tout entiere autour du nerf exacerbe, atrophie qui va de ma tete а mes pieds. Ma jambe se souleve toute seule. Je voudrais crier Dieu! et mourir dans moi, mourir dans moi. J'ouvre les yeux, c’est encore l'oreiller que j’apercois, et la couleur rose pale du drap. Je halete entre le flou et la nuit. Je voudrais etouffer la vie qui me ronge, commettre un meurtre, le mien. Mon corps me fait mal et c’est quand il me prend qu’il creve l’abces, c’est le mal qui jouit dans une crampe detonante, et le liquide coule, blanc comme du pus.
Posee lа, nue, а decouvert, enfin prete а mourir sereine et abandonnee. Je ne veux pas m’endormir de peur que mes reves ne me menacent encore et que mes insomnies ne ressemblent а mes reves. Je ne veux pas rester seule, j’ai peur de trop vouloir mourir, et que ce Dieu que j’implore ne soit un traitre, ne me faisant crier son nom que pour me perdre dans son echo.
J’etais une ame morte, lui etait vivant, jeune, il n’avait rien de mort en lui. Je comprenais que, pour la premiere fois, j’avais approche les tenebres de si pres que meme eveillee, j’y tombais.
Il fallait partir, changer d’appartement.Je pourrais faire un grand voyage. Je pourrais aussi m’isoler, aller а la campagne, lа-haut, sur la colline, et marcher, ecrire, penser. Mais tout change quand le telephone du lundi commence а sonner. Le courant des affaires exclut toute idee d’eloignement, il faut rester lа ou le telephone sonne, et hachurer chaque heure de son agenda de rendez-vous, discuter de l'avenir incertain avec des paroles approximatives et attendre comme au jeu du loto que chaque pion trouve sa case. Ainsi les choses s'organisent-elles dans le plus grand des hasards.
Je vais donc partir aux Ameriques voir si ce n’est pas lа-bas que se trouve le rendez-vous. Mon agent n'y voit pas d'inconvenient et semble meme soulage de m
evoir partir m'occuper ailleurs. Peut-etre reviendrai-je riche et celebre.
Rien que l’annonce de mon depart pour Hollywood fait plus de bruit et declenche plus d’enthousiasme que si j’en revenais avec un contrat signe de la Paramount, pour le role titre partage avec Robert De Niro. Je pars en me disant que je n'ai rien а perdre. Effectivement je n’y ai ni perdu, ni gagne, sauf le respect navrant de ceux qui me veulent arriviste. Il a fallu que j’aille bien loin pour comprendre une fois de plus que je ne peux en rien changer le cours des choses.
Mais j’y etais. Voilа mes bagages qui arrivent et je tremble devant les flics americains qui fouillent mon sac — chaussures vernies, flingue, et habit reglementaire debraille qui leur donnent un air malsain. Le cow-boy me regarde, je suis donc coupable, coupable d’avoir un sac et d’etre dans cet aeroport. Ils observent les allees et venues des etrangers et chopent les plus etranges. D’un geste du doigt, ils accusent et epinglent l’espece humaine ployant sous le poids des bagages, reduite а cette seule propriete, comme des vagabonds n’ayant d’autre patrie que ces sacs. Cela ressemble а une prison par laquelle il faut d’abord passer avant de se faire jeter dans la ville. Ils vous accusent d’abord, puis vous relachent, trempee de peur, d'insecurite, de culpabilite. Je voudrais revoir mes albums photo, caresser mes chiens et deposer une petite fleur seche aux pieds de mon Bouddha prefere, mettre mes pantoufles et faire la cuisine. Et juste leur faire comprendre que je suis honnete, leur raconter ma vie pour qu'ils sachent que je ne suis pas si mal que ca. J'ai peur, et je sais que j'aurai toujours peur ailleurs que chez moi. Je suis partie trop vite.
Je me suis mis dans la tete de faire un voyage et mon impatience m'a precipitee dans tout ce qui bouge. Le corps deshydrate et somnolent, je suis seule dans le bleu nuit du ciel californien. A sept heures, c'est dejа le soir. Il se dessine des figures etranges, de grands oiseaux qui plantent leurs becs de fer dans le sol et se balancent d'avant en arriere, sans l’ombre d’un hoquet, sur les collines etendues de chaque cote de l’autoroute. La couleur de l’air est orange, le ciel turquoise — rien ne se confond ici, tout est clair, delimite, simplifie. La ville s’etend, plate comme l'eau
.Les rues noires, droites et quadrillees, qui fuient perpendiculairement, ressemblent aux barreaux d’une prison. Peu de passants qui passent, et meme personne. Des grandes surfaces eclairees et des maisons les unes а cote des autres.
L'ami de mon amie m'attend.
On aurait dit qu’il etait plus tard — la nuit peut etre trompeuse. Dans la maison ou je rentre, il n’est que huit heures, il s’apprete а sortir diner. Il sent la douche fraiche avec ses cheveux mouilles, son parfum encore trop fort. Il prend mes sacs et me regarde gentiment, m’ouvre sa maison et son coeur, comme si nous nous connaissions depuis vingt ans.
Sa maison est simple, c'est-а-dire pas compliquee. Des espaces confortables avec des gros canapes, un billard, une cuisine surequipee, des chambres avec salle de bains, des placards bien ranges. Dehors, une terrasse et la piscine. Deux garages ouvrent leur gueule en haut d’un chemin qui monte. Ma chambre est en bas, entre la cuisine et le salon.
Dans le gros refrigerateur, il y a des trucs nouveaux avec des emballages inconnus. Il faut lire l’etiquette de chaque pot pour savoir ce que c’est, mais, pour le moment, je me rabats sur du fromage avec un verre de vin blanc californien.
La nuit, d’un seul ton depuis tout а l’heure, n’a pas change. Elle se coule dans la vallee comme une longue raie fatiguee. Les etoiles se multiplient et pendant que je les regarde, la nuit devient blanche. Les maisons s’emboitent sur la machoire de la colline. Nous sommes en hauteur, en equilibre au-dessus de la ville.
J’ai les numeros de telephone de mon agent americain — et deux ou trois autres, de gens que je ne connais pas, recoltes au hasard d’une rencontre parisienne. Le premier est celui de son bureau, avec un numero de poste et les prenoms de ses deux secretaires. En dessous, ecrit а la main, celui de sa maison particuliere — juste le numero. Pas d’adresse.
Avec mes lunettes de soleil et ma jupe а fleurs, je n’ai rien а craindre. Tres vite, je me suis rendu compte que je n’etais pas dans le gout du moment, et que j’avais plutot l'air planplan dans ma voiture de location decapotable. Qu’importe: j’y suis, j’y roule! Il fait chaud, les arbres palmiers
et les gazons sont beaux, les maisons propres. Des toupies de pluie eclaboussent de gouttelettes microscopiques les fleurs grasses des jardins. Au passage, mon front s’humecte d'un voile de rosee diurne. J’arrive vers l'hotel des Quatre-Saisons et vire а gauche, m’eloignant des plantes et des ombres, leur tournant le dos, pour affronter le beton plus cru que le ciel qui l’enserre, massif et dur. Dans la chaleur, ces blocs blancs comme du beurre sorti du refrigerateur se transforment en vapeur de sable. La nature n’existe plus, ici tout est droit, fou. Je penetre dans ce royaume du sable et de l’or, glissant sur le pave lisse comme une patinoire. J'avance, engluee dans l'air brulant, si epais que le bruit du moteur s'eteint.
J'entends sa voix avant de la voir. Elle parle fort mais clairement, sans donner l'impression de crier. Chaque syllabe est aussi precise que l’indication d’un chemin bien connu. Donnant une longueur particuliere а chaque mot. La musique lancinante de son monologue ne laisse transparaitre aucune emotion. Elle m’attend: il y a du the chaud qui fume sur la table basse. La piece est grande, eclairee comme dans un magazine de decoration style Santa Fe. Le store а moitie ferme rayure ce qu’il faut de lumiere. Sur son bureau, de jolies piles de paperasses, des pots de terre avec des regles et des crayons dedans, et des fleurs. Ce sont ces objets qui, les premiers, me voient penetrer chez eux, modifiant l’equilibre de leur espace et, d’une respiration profonde, etablissant une autre formation d’atomes. Deuxieme respiration, j’ai l’epiderme sur la defensive, je suis nerveuse et trop grande, debout ainsi au milieu de la piece. Lieu inconnu. Premiere rencontre. L’anglais. Ma jupe qui est froissee. J’ai l’air fatiguee. Je me suis trop maquillee.
Je finis par demander un the dont je n’ai pas envie et par m’asseoir sur le canape ou je n’ai pas envie de m’asseoir. Je sais que le the ne sera pas bon, et surement trop chaud. D’ailleurs, les tasses non plus ne sont pas des vraies tasses а the, c’est-а-dire en porcelaine, comme il se doit, concues pour que l’ouverture des levres provoque la quantite egale de salive et de the pour la deglutition. Elle, elle ingurgite gentiment des litres de Coca-
