
- •Фонд развития международного университета
- •Ноу средняя образовательная школа «Росинка»
- •Исследовательская работа
- •История русской эмиграции во Франции
- •И французской – в России.
- •Sommaire
- •Introduction
- •1. Les traces de la France en Russie
- •1.1. Les premiers contacts des Fraçais avec des Russes
- •1 .2. Les échanges avec la France sous Pierre le Grand
- •1.3.L'émigration française en Russie au xviiIe siècle
- •1.4. Les entrepreneurs français en Russie au xiXe siècle.
- •1.4.1. Les sociétés franco-russes
- •1.4.2. Les viticulteurs de Chabeau
- •2. Les Russes en France
- •2.1. Etapes de l’émigration russe
- •2.1.1. Causes de l’émigration avant la révolution de 1917
- •2.1.2. L'émigration blanche
- •2.1.3. L’émigration après la deuxième guerre mondiale
- •2.1.4. La troisième vague
- •2.2. La culture russe sur le sol français
- •2.2.1. Ivan Serguiévitch Tourgueniev
- •2.2.2. La gloire russe à l'Opéra de Paris
- •2.2.3. Marc Chagall
- •Conclusion
- •Bibliographie
- •Annexe 1 Histoire de l’émigration française en Russie История французской эмиграции в России
1.3.L'émigration française en Russie au xviiIe siècle
L es
Français, arrivés en Russie au XVIIIe
siècle étaient si nombreux, qu'on pouvait parler
d'une vague d'émigration, fuillant la révolution française d'un
côté, et les perquisitions
des protestants, de l'autre. Selon quelques estimations, entre 1789
et 1792
il y avait 10 000 français établis en Russie.
es
Français, arrivés en Russie au XVIIIe
siècle étaient si nombreux, qu'on pouvait parler
d'une vague d'émigration, fuillant la révolution française d'un
côté, et les perquisitions
des protestants, de l'autre. Selon quelques estimations, entre 1789
et 1792
il y avait 10 000 français établis en Russie.
Catherine II, dont les relations avec les esprits les plus brillants du siècle des Lumières ont favorisé l’expansion française dans l’Empire russe , a parfaitement su utiliser ces liens comme porte-voix de la Russie pour séduire, intéresser, attirer et gagner l’opinion publique française.
Catherine II était allemande d’origine mais fut la plus russe des impératrices. Elevée par une Française elle connaissait à fond les grands écrivains français. Catherine II était en correspondance avec Voltaire, Diderot et d'Alambert. Ses contacts avec Voltaire étaient mal vus par le métropolite Platon et Catherine devait lui expliquer que ses lettres adressées à un athée ne comportait pas de menaces à la religion. Le 6 juillet 1762, neuf jours après le coup d'Etat qui l'a faite souveraine de l'Empire, elle a proposé à Diderot de publier son Encyclopédie à Petersbourg ou à Riga et l'a invité en Russie. L'Encyclopédie était publié en France, mais en 1772, dix ans après la première invitation, le philosophe est tout de même arrivé à Petersbourg. Les « Mélanges philosophiques et historiques » de Diderot, fruit de ses conversations avec l'impératrice, montrent que ces conversations portaient sur le système politique, l'éducation, le théâtre etc. Malgré ces conversations et les signes de la sympathie que Catherine manifestaient à Diderot, la haute société russe l'a accueilli très froidement. Ses relations avec les compatriotes, qui habitaient en Russie, n'étaient pas faciles non plus, sauf les relations avec Falconet.
A cette époque un grand nombre de Français de toutes origines vinrent chercher fortune en Russie . « Il pleut des Français en Russie, disait un diplomate, comme des insectes dans les pays chauds ». La plupart des Français travaillait comme précepteurs dans des familles, comme «outchitels » (maîtres). Une partie des émigrés qu'on considérait Français descendaient des provinces de l'est, dont beaucoup de Franche-Comté, attachée à la couronne seulement sous Louis XIV, d'autres prévenaient de l'Alsace, de la Lorraine ou de la Suisse. Ils parlaient les deux langues - le français et l'allemand, mais en Russie on les appellaient tous Français.
L'attitude envers les Français qui habitaient en Russie n'était pas toujours bienveillante. On peut dire, qu'il existait un paradoxe entre la notoriété du livre français, d'un côté, et une certaine méfiance à l'égard des Français réels, habitant tout près et diffusant directement des idées et opinions répandues en France . Il suffit de se rappeller la caractéristique du gouverneur français faite par Eugène Onéguine, qui est plutôt ironique.
L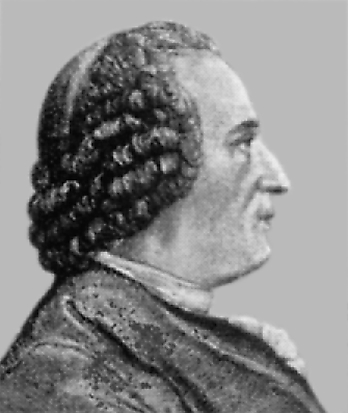 es
Français en Russie ne constituait pourtant pas de groupe homogène.
Les premiers rôles
étaient joués tout de même par les hommes de l'art, dont, par
exemple, le sculpteur Falconet,
auteur de la célèbre statue de Pierre le Grand, ou de la science,
par exemple, Diderot,
qui n'était pas du tout émigré et qui était venu en Russie sur
l'invitation de Catherine
II.
Le
personnel enseignant français comptait beaucoup d'hommes
de mérite, dont Labaume, Dassier, lecteurs à l'Université de
Moscou, Saint-Julien,
lecteur à l'Université de Saint-Pétersbourg, Duvillard, professeur
à l'Université
de Kazan, beaucoup d'autres professeurs d’ universités et de
gymnases.
Mais dans l'enseignement privé on pouvait rencontrer d'autres
individus.
es
Français en Russie ne constituait pourtant pas de groupe homogène.
Les premiers rôles
étaient joués tout de même par les hommes de l'art, dont, par
exemple, le sculpteur Falconet,
auteur de la célèbre statue de Pierre le Grand, ou de la science,
par exemple, Diderot,
qui n'était pas du tout émigré et qui était venu en Russie sur
l'invitation de Catherine
II.
Le
personnel enseignant français comptait beaucoup d'hommes
de mérite, dont Labaume, Dassier, lecteurs à l'Université de
Moscou, Saint-Julien,
lecteur à l'Université de Saint-Pétersbourg, Duvillard, professeur
à l'Université
de Kazan, beaucoup d'autres professeurs d’ universités et de
gymnases.
Mais dans l'enseignement privé on pouvait rencontrer d'autres
individus.
Depuis Pierre le Grand les agents spéciaux retiraient ou recuieillaient partout en Europe des militaires, des ingénieurs, même des aventuriers de toutes genres pour les faire venir en Russie. Les nouveaux arrivés se disaient tous barons, marquis ou comptes, mais en réalité ils pouvaient ne pas avoir de culture ni de formation. Très souvent ces gens s'engageaient comme outichels dans des familles russes sans avoir aucune expérience dans ce métier ni de connaissances suffisantes.
Il y avait encore une catégorie de Français qui habitaient en Russie, pas très nombreuse, mais pourtant importante. C'étaient des calvinistes du Languedoc, de l'Alsace, de la Lorraine qui étaient arrivés pour cultiver la terre. Mais en réalité ils sont aussi devenus outchitels. Les autorités russes se plaignaient que les Français ne voulaient pas exploiter la terre et avaient quitté leur village pour enseigner le français dans les familles des aristocrates de province. Les Français, à leur tour, se plaignaient que les autorités locales n'étaient pas prêtes à les recevoir et ne leur avaient pas assuré les conditions promises par les agents russes en Europe. En plus, ils supportaient difficilement le climat de la région. Cette première expérience a donc échoué.
