
- •Isbn 2-02-026149-9 ©Éditions du Seuil, juin 1996
- •II. Repérer ce qui est commun au commentaire composé et à l'explication de texte
- •La séquence narrative
- •Confronter
- •Rendre visibles les articulations du devoir
- •Les titres
- •I et plus particulièrement des noms de
- •I. Savoir
- •Organiser le commentaire composé
- •Mettre en forme
- •Exemple
nçais
ïftres
N
 athalie
Marinier
athalie
Marinier
Commentaire composé et explication de texte
SEUI
LCommentaire composé et explication de texte
Nathalie Marinier
Professeur agrégé de lettres modernes Chargée de cours à I*université d'Orléans

Seuil![]()
Collection dirigée par Jacques Généreux et Edmond Blanc Extrait du catalogue
FRANÇAIS - LETTRES
Aborder la linguistique. Dominique Maingueneau
les Grands Courants de la critique littéraire. Gérard Gengembre
Les Termes clés de l'analyse du discours. Dominique Maingueneau
Les Termes clés de l'analyse du théâtre. Anne Ubersfeld
L'Analyse des récits. Jean-Michel Adam et Françoise Revaz
L'Argumentation. Christian Plantin
Le Comique. Jean-Marc Defays
La Conversation. Catherine Kerbrat-Orecchioni
Le Roman. Gilles Philippe
Commentaire composé et Explication de texte. Nathalie Marinier
La Dissertation littéraire. Hélène Merlin
PHILOSOPHIE
Les Grands Courants de la philosophie ancienne. Alain Grof
Les Grands Courants de la philosophie moderne. Alain Graf
Les Grandes Œuvres de la philosophie ancienne. Thierry Gontier
Les Grandes Œuvres de la philosophie moderne. Thierry Gontier
Lexique de philosophie. Alain Graf et Christine Le Bihan
36. Les Grands Courants de la philosophie politique. Michel Terestchenko HISTOIRE
La Révolution française. Jean-Clément Martin
Bilan de la Seconde Guerre mondiale. Marc Nouschi
La IV" République. Jacques Dalloz
1 5. Les Relations internationales depuis 1945. Philippe Moreau Defarges
La Construction européenne de 1945 à nos jours. Pascal Fontaine
Le Commentaire de documents en histoire médiévale. Jacques Berlioz
La Grande-Bretagne depuis 1945. Roland Marx
Les Relations Est-Ouest depuis 1945. Pascal Boniface
Histoire des politiques sociales (Europe, xoC-xx* sièclej. Francis Démier
Les Décolonisations. Bernard Droz
Isbn 2-02-026149-9 ©Éditions du Seuil, juin 1996
Le Code de lo propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
SOMMAIRE
SAVOIR
DÉFINITION DES EXERCICES
Des principes intangibles
Ce GUE l'on est supposé connaître
II. Repérer ce qui est commun au commentaire composé et à l'explication de texte
S
26
36
45
48
ituer le texte dans l'œuvreCARACTERISER
Les outils lexicaux
Quelques outils grammaticaux
Quelques outils syntaxiques.
Quelques outils stylistiques .
ORGANISER LE COMMENTAIRE COMPOSÉ
Construire une interprétation
Construire un plan de commentaire
composé
METTRE EN FORME
La présentation du commentaire composé .
L'introduction
La conclusion
EXEMPLE
Commentaire composé
Glossaire
Conseils de lecture
DÉFINITION DES EXERCICES
A. LES ATTENTES OFFICIELLES a. Entre liberté...
Des exercices rigoureux. L’explication de texte littéraire et le commentaire composé sont deux épreuves qui constituent autant d occasions d éprouver la solidité d’une culture littéraire, de mettre en présence un écrit et des habitudes de lecture au cours d un jeu subtil qui consiste à déjouer les subterfuges du texte, tout en cédant à l’émotion. En ce sens, ils permettent véritablement au lecteur d’exercer sa liberté, faite de respect et d’audace, pour apprécier d’autant plus un texte singulier qui met en œuvre des ingrédients universels.
Une nécessaire audace. Avant d’entrer dans le détail d’un propos méthodologique qui peut certainement dans un premier temps faire passer au second plan le « plaisir du texte », il nous faut insister sur un défaut trop souvent répandu ; la prudence excessive face au texte qui invoque comme alibi une lecture légitime, celle que délivrerait une institution, un maître. Cette lecture légitime n existe pas. Tant que le lecteur apporte la preuve textuelle de ce qu’il avance, il est toujours possible d’élaborer une interprétation par une investigation scrupuleuse.
P. Valéry le reconnaissait lui-même :
« ...il n'y a pas de vrai sens d'un texte. Pas d'autorité de l'auteur. Quoi qu'il ait “voulu dire", il a écrit ce qu'il a écrit. Une fois publié, un texte est comme un appareil dont chacun se peut servir à sa guise et selon ses moyens : il n est pas sûr que le constructeur en use mieux qu'un autre. »
(« Au sujet du Cimetière marin », Variété.} b.... et contraintes
Un exercice connu. L’explication de texte est pratiquée depuis longtemps par les étudiants mais une sorte de trompeuse connivence laisse en fait dans l’ombre les préalables de cette épreuve. Comme si cela allait de soi parce que cela s’est toujours fait ainsi... Or, cela ne va pas de soi d’abord parce que l’on pourrait s’interroger sur tous les présupposés qui tendent à faire de 1 œuvre littéraire un réservoir illimité de « morceaux choisis », d’ouvrages sécables à l’infini pour les besoins d’un exercice institutionnel. Ensuite, l’explication de texte a évolué depuis sacréation officielle à la fin du MX siècle et il est attendu que cer tains apports de la lecture critique contemporaine soient utilisés « bon escient. Enfin, cela ne va pas de soi parce qu'il ne suffit pas de se présenter devant un texte avec une pratique convenable de la langue, un goût pour la littérature, une certaine aisance oratoire, pour arriver à rendre compte des enjeux de ce texte. 11 convient de rappeler que certaines évidences recouvrent en fait des attentes très fortes, très exigeantes.
Un exercice précisément détint. Ljt-.xjslka.ijon de texte est d’abord une confrontation rigoureuse avec un texte court (20-25 lignes, mais le sonnet est fréquemment proposé à l’étude), soigneusement délimite, dont le lecteur va mettre en lumière la signification et la portée. Le sens étymologique d'« explication » est : dérouler les fils ·■ impliques >■ dans le tissu du texte (impli- care\ plier dans, entortiller, emmêler, envelopper); 1’*explication », c’est bien l’art d’« expliquer » (explicare: déployer, dérouler, débrouiller, développer . L’explication de texte est linéaire : cela sc justifie largement par le respect du texte qui se déplie ligne à ligne. Toute la stratégie d’un texte repose sur cette découverte, celle des motifs, des errances, des reprises, des équivoques, des indices apparemment déconcertants.
I.a spécificité du commentaire composé. Il s’oppose d abord nettement à l’explication de texte parce qu’il s’interdit la linéarité. En outre, le produit fini est un second texte et non pas une épreuve orale (sauf cas - très - particulier). Il présenté donc le grand mérite d’associer une pratique de la lecture et de 1 écriture. Le commentaire est en effet composé : il propose un bilan de lecture organisé.
B. DES EXERCICES CONNUS MAIS DIFFÉRENTS
Différences
Ce sont des exercices habituels dans les classes du second cycle, dont les élèves sont bien entraînés à la pratique de l’explication de texte.
• De la lecture méthodique à l’explication de texte. Au lycée, ^explication de texte, sous le nom de lecture méthodique - « lecture réfléchie qui permet aux élèves d’élucider, de confirmer ou de corriger leurs premières réactions de lecteurs » {Instructions officielles pour la <lasse de seconde)-, privilégie souvent un axe d’étude mettant l’accent sur une méthode parmi d’autres de « détissage » du texte. Or l’explication de texte, dans un cadre universitaire, a une exigence d’exhaustivité et ne fait grâce au texte d’aucun détail.
• Un commentaire à composer en toute liberté. De même, k commentaire composé proposé lors de l’épreuve anticipée du baccalauréat s’accompagne souvent d’un sujet dont le libellé peut suggérer une approche, au moins initiale, du type : « Vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous pourrez étudier, par exemple, comment l’expression de sentiments personnels mène à une réflexion sur la nature et la condition humaines. » En revanche, dans un cadre universitaire, aucune direction de lecture n’oriente le commentaire composé.
Points communs
I.a maîtrise du commentaire composé suppose celle de l’explication de texte car tout commentaire se fonde nécessairement sur une analyse détaillée du texte. Pour cette raison, nous ne distinguerons pas les conseils pour l’explication de texte de ceux destines au commentaire composé sauf lorsque la différence impose des règles particulières.
Les qualités requises par ces exercices sont :
des connaissances littéraires et historiques ;
un respect absolu du texte ;
un usage pertinent des outils d’analyse.
Comment il faut lire ce livre
Un effort à poursuivre. La lecture de ce livre ne remplacera ni la fréquentation assidue des œuvres littéraires grâce à laquelle se développent goûts et préférences en .l’excluant pas les auteurs étrangers (nous pensons à Cervantes, Borges, Calvino...) ni la constitution d un oeil critique exerce par les textes fondamentaux. Proposant des explications partielles et complètes, il ne souhaite pas entretenir l’illusion d’exempter le lecteur’de cet effort.
Une complicité à entretenir. Il a l’ambition de favoriser une rencontre personnelle avec le texte, de donner les moyens d’une véritable entrée dans le texte et dans la littérature, de permettre de circuler dans I espace littéraire avec aisance et de renouveler le désir de voyager, pour reprendre la belle métaphore de Michel de Certeau dans L’Invention du quotidien :« Bien loin d'être des écrivains, fondateurs d'un lieu propre, héri- -j tiers des laboureurs dantan mais sur le sol du langage, creuseurs de puits et constructeurs de maisons, les lecteurs sont des voyais · ils circulent sur les terres d'autrui, nomades braconnant à fravers les champs qu'ils n'ont pas écrits, ravissant les biens d'Égypte pour en jouir. »
DES PRINCIPES INTANGIBLES
L’explication de texte repose sur un mouvement alternatif entre le texte et des hypothèses de lecture qu’il suscite et authentifie; il ne faut donc privilégier aucune voie d’approche pour étudier non pas seulement pourquoi un auteur « dit » cela (ce qui est souvent assez simple à déterminer) mais comment il le « dit ».
A. L'ANALYSE DÉTAILLÉE D'UN TEXTE
Deux pièges à éviter
Refuser la «grille» de lecture. L’explication n’est pas une simple lecture. Klle n’a pas à appliquer une « grille » critique particulière, pas plus qu’elle n’est, autorisée à défendre une méthodologie singulière. Il est fortement recommandé de recourir à une méthode éclectique, celle qui emprunte aux divers systèmes les thèses les meilleures quand elles sont conciliables, plutôt que d’édifier un système nouveau et périlleux. Pour ce faire, on n’hésitera pas à parcourir toutes les voies susceptibles d’aiguiser la lecture d’un texte sous réserve de garder en mémoire que ce travail ne fait que préparer l’interprétation, qu’il ne la remplace pas.
L’ccueil de la paraphrase. Si la lecture linéaire ne fait grâce d aucun détail au texte, elle doit pour autant éviter la paraphrase. Dans le pire des cas, cette pseudo-analyse redondante consiste à répéter de façon nettement moins élégante ce que la simple lecture du texte a déjà fait comprendre. Plus généralement mais tout aussi peu efficacement, elle propose souvent une simple mise à plat qui gomme tous les effets du texte.
Un exemple d'analyse détaillée
« Il n avoit plus conscience du milieu, de l’espace, de rien ; et battant le sol du talon, en frappant avec sa canne les volets des boutiques, il allait toujours devant lui, au hasard, éperdu, entraîné. » (Flaubert, L'Education sentimentale, première partie, chap. iv )
C est la première phrase d’un texte reproduit plus loin ( f chapitre 15), auquel nous ferons souvent référence.
Un héros romantique. D’emblée, le texte fait réference au topos romantique de la passion : Frédéric Moreau sort de sonremier dîner chez M“*c Arnoux. Cette passion est ici mise en valeur par la pesée négative <« ne plus ») qui, aussi bien quantitative que temporelle, signale la dissolution du moi dans un espace-temps indéfini. Celui-ci est évoqué par la gradation « milieu », « espace », « rien » et par l’adverbe - toujours > qui renforce l’aspect duratif ici de l’imparfait.
U
 n
délire complaisant. Le redoublement d’une structure binaire
(syntagme prépositionnel «
devant lui »
et la locution adverbiale «
au hasard »
suivis de deux participes passés, «
éperdu » et «
entraîné ■>)
prolonge sur le plan syntaxique cet abandon dans l’errance.
L’absence de complément d’agent après «
entraîné » confirme cette idée de depossession
de l’être
mû par une force qu’il ne connaît
pas. Frédéric est comme aveugle et guidé par le seul bruit («
frappant avec sa canne »).
n
délire complaisant. Le redoublement d’une structure binaire
(syntagme prépositionnel «
devant lui »
et la locution adverbiale «
au hasard »
suivis de deux participes passés, «
éperdu » et «
entraîné ■>)
prolonge sur le plan syntaxique cet abandon dans l’errance.
L’absence de complément d’agent après «
entraîné » confirme cette idée de depossession
de l’être
mû par une force qu’il ne connaît
pas. Frédéric est comme aveugle et guidé par le seul bruit («
frappant avec sa canne »).
La résistance du réel. Si les contours du monde réel disparaissent, pour autant les deux participes présents « frappant » et « battant » fonctionnent comme un retour d’une réalité éloignée des pensées qui, nous le verrons plus tard, agitent Frédéric. En effet, on peut penser que le terme « boutique » connote le monde du petit profit rompant ironiquement avec l’exaltation du personnage. Là s’amorce dé)à la perception d un regard distancié du narrateur sur ce héros à la conscience brouillée.
B. LA DYNAMIQUE DU TEXTE
a. Une vue d'ensemble
Un texte s’observe selon une structure interne, une dynamique propre, que l’on appellera « mouvement ». Il s agit de bien discerner les différents élans, reculs de ce mouvement pour être sensible à une composition générale. Il ne s’agit pas d établir un plan du texte dans lequel les coupes seraient autant de violences faites, mais de distinguer les critères pertinents de son organisation interne.
11 s’agit d’être particulièrement attentif quand on étudie un texte de théâtre où l’acte classique est fréquemment organisé comme une petite pièce, où la scène met en abyme” la structure de I acte °u de la pièce en comprenant toujours une intrigue, son dénouement progressif et ses éventuelles péripéties.COMMENTAIRE COMPOSÉ
b· Des modèles de construction
En quoi cette organisation interne permet-elle de construire un sens ? Ce n est pas une simple formalité, il est essentiel de mettre en lumière une construction le plus souvent savante.
Le discours ant^ue pour mission de persuader et se décliné selon les trois genres suivants : judiciaire, délibératif et épidienque (ou démonstratif). La rhétorique latine l’ordonne en six parties: l’exorde ou introduction, la proposition, la narration, la preuve, la réfutation et la péroraison (conclusion destinée à émouvoir et à emporter l’adhésion).
Variation sur un modèle. Il en est ainsi du texte suivant de Jean-Jacques Rousseau, le préambule aux Confessions, un texte a visée nettement épidictique qui ne se comprend qu’en réfé- rence au discours latin.
«Je forme une entreprise qui n'eutjamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur.! Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme, ce sera moi.
Moi seul. Je sens mon cceur, et je connais les hommes. Je ne suis rait comme aucun de ceux que j'ai vus; j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le
moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu après m'avoir lu.
Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra- |e viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement : Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fusJJ'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon; et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais etre faux. Je me suis montré tel que je fus ; méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime, quand je l'ai été · j'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même, Être éternel. Rassemble autour de moi l’immense foule de mes semblables; qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indigni- tes, qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre a son tour son cceur au pied de ton trône avec la même sincérité
et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose : “Je fus meilleur que cet nomme-là." »oES PRINCIPES intangibles 11
On identifie nettement comme exordc «Je forme une entre- », comme proposition « Je veux », où le projet du livre Se
L (-lairement, comme narration « Moi seul. [·.·] ce que je fus », c preuve.« J'ai dit le bien », ou le passage au passe compose témoigne des pièces versées au dossier d’une défense après une iiauête comme réfutation « Rassemble autour de moi », enfin comme péroraison, accentuée par le subjonctif, « et puis qu un seul te dise, s’il l’ose : “Je fus meilleur que cet homme-la. »
Ici la recherche du mouvement du texte se justifie pleinement,. inscrit délibérément Les Confessions dans le projet traditionnel de réhabilitation annonçant d’emblée le paradoxe de la sincérité et de la rhétorique, cette ambivalence qui fan le sel de tout ouvrage autobiographique. Renvoyant à l’cpoque classique, il signale aussi dès son titre l’hommage rendu au prédécesseur saint Augustin et à scs Confessions.
e. LE REFUS BE L'EXCLUSIVITÉ SÉMANTIQUE
Ce sont naturellement les effets produits par le texte qui sont les plus intéressants à débusquer, à démonter. Se limiter .* mettre au jour le sens du texte, ce qu’il veut dire est somme toute élémentaire. En revanche, étudier comment un texte dit ce qu il dit revient à en étudier le fonctionnement.
Trois niveaux d'analyse
L’analyse d’un texte peut être comparée à un forage, une aventure à la recherche d’un sens provisoirement (pour les besoins de l’exercice !) perdu. On peut considérer qu’il existe trois niveaux
d’analyse.
Le texte dans son immanence. Le texte existe indépendant- ment de celui qui l’a créé et de celui qui le perçoit. Chaque degré de l’analyse, linguistique, lexical, phonique, morphosyntaxique, sémantique, rhétorique et éventuellement métrique, doit a ois être convoqué pour, en cas de récurrence de certaines caracte- ristiques, faire sens.
Le texte comme production. On prend en compte tout ce qui concerne la production du texte ; le style y est défini comme intention et comme choix de l’auteur.
Le texte comme effet d’un acte de lecture. Est concernée a réception de l’ccuvrc qui dépend de l’espace et du temps. Là, <- texte fonctionne toujours nlus ou moins comme test pioiccti'■ ■ '·' -V Г Л ’ А I |( t СО м Р о <- £
pour к· k-crcm et ]■■ explication en apprend autant sur celui qui Га construire que sut* le texte lui-même.
• Г’explication comme analyse intégrale. Interpréter revient interroger le texte sur les faits pertinents du niveau immanent qui cm le fondement de toute explication, en les mettant en relation avec les intentions de production et les eîicis de lecture C es. un subtil équilibre à trouver pour rendre compte d une sitUcj ion de communication particulière.
Les fonctions de la communication
Pour ce faire, on peut s’appuyer sur le célébré schéma de la
communication que- propose Roman Jakobson dans ses Essais de linguistique générale :
• Ce schéma de la communication sc définit ainsi :
referent
é
récepteur
metteur —— messagecanal
code
UtI émettcur -Mresce un message a un récepteur. Pour que ce message soit reçu, il faut satisfaire trois conditions :
qu'une voie de communication appelée uwal (voix, ondes sonores, papier) existe;
que l’émetteur et le récepteur utilisent le même svstème de
signes, une même langue, qu’on appelle code pour que le nies- sage puisse être compris;
que la communication porte sur un ou plusieurs objets de la icalitc, sur une situation : le réfèrent.
(. est dans le cadre de cette fonction de communication que Jakobson a defini six fonctions particulières, selon l’accent mis sur un des cléments du schéma de la Communication • la lonct.cn fêtèrent ici le renvoie aux objets du monde, réels ou fictifs, et concerne donc l’ensemble des référents formant le contexte du message. Elle est indispensable a I élaboration d’un univers poétique ou romanesque.
; D°nS ,es premiers i°urs de 1830, tou» le monde parlai, à Paris de la passion de Nucingen e» du luxe effréne de sa maison te pauvre baron, affiché, moqué, pris d une rage facile à concevoir mit alors dans sa tete un profet de financier d'accord avec la furieuse pas- sien qu i) $e sentaïf ou coeur. »
[Balzac Splendeurs et Misères des courtisanes, j
, r . p L S INTANGIBLES
oEs ^lS°
, -fi,entiel est d’eniblce déterminé par l’inscription spa- U CadrCDorelle (« premiers jours de 1830 », « Paris »), par l'.den- (« le baron » de » Nucmgen »).
'^ fonction expressive (ou émotive) renvote a 1 émetteur du • dont elle révèle les émotions et réactions affectives.
« Mon beau navire 6 ma mémoire Avons-nous assez navigué Dans une onde mauvaise à boire Avons-nous assez divagué De la belle aube au triste soir »
(Apollinaire, « La Chanson du Mal-Aimé », Alcools )
Elle se révèle en particulier par l'usage des interjections, des exclamations, (« Mon beau navire ô ma mémoire »).
Cette fonction est souvent privilégiée dans es textes lynqi es.
• La fonction conative (ou impressive) est la fonction d appe au destinataire sur lequel le message s’efforce d agir.
« La vie humaine est semblable à un chemin dont l'issue est un précipice affreux. On nous en avertit dès le premier pas; mais la loi est portée, il faut avancer toujours Je voudrais retourner en arriéré. Marche! Marche! Un poids invincible, une force irrésistible nous
entraîne. » , . , # v
(Bossuet, « Sermon pour ie jour de Vaques ».)
Elle se signale par le recours aux apostrophes, aux impératifs (« Marche ! Marche ! »).
• La fonction phatique concerne le contact entre le locuteur et l’interlocuteur : elle l’établit, le maintient ou le rompt, bile est centrée sur le canal.
Le pompier. - Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame Smith. Vous avez I air fâché M"® Smith. - Oh !
M. Smith. - C'est que, voyez-vous .. ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison.
M. Martin. - Il y a eu, monsieur le Capitaine des pompiers,
une controverse entre madame et monsieur Smith.
(Ionesco, ta Cantatrice chauve, sc VIII.)
Ces deux fonctions, phatique et conative, sont déterminantes lorsqu’il s’agit d’analyser un dialogue, un texte polémique,
argumentatif.La fonction métalinguistique renvoie au code utilisé, a 1; langue et à ses cléments constitutifs, le langage parle de lui meme, on travaille sur les mots eux-mêmes, utilises de facor antonyme1'.
CaSSanDRE. - Paris ne tient plus 6 Hélène ! Hélène ne tient plus à Pcris! Tu as vu le destin s'intéresser à des phrases négatives 2 Andrcmaque. - Je ne sais pas ce qu'est le destin.
Cassanorh. - Je vois te ie dire. C est simplement la forme accèlè rée du temps. C'est épouvantable.
Andromagué. - Je ne comprends pas les abstractions.
CaSSANDRE. - A ton aise. Ayons recours aux métaphores. Figure-io· un tigre Tu la comprends, ceiie-iô? C'est la métaphore pour jeunes filles. Un tigre qui dort?
(G/raudoux La guerre de Troie n'aura pas lieu, acte I, sc. \.)
ici le commentaire métalinguistique (« métaphores », « phrases négatives·») traduit bien l'impuissance de Cassandre à se faire entendre par les futures victimes de la catastrophe qu’elle annonce. A proprement parler, le message ne passe pas, même si Cassandre s’assure qu’Andromaque utilise le mémo code (« Tu la comprends, celle-là ? C’est la métaphore pour jeunes filles. »}.
La fonction poétique s’appuie sur le message en tant que tel. par exemple le choix d’un mot pour sa sonorité. C’est un type de relation centré sur l'organisation du texte lui-même (effets de symétrie, superpositions...), son écriture.
* Il pleure dans mon cœur Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur Qui pénètre mon cœur ? »
(Verlaine, Romances sons paroles.]
On note ici le jeu sur les relations associatives établies au niveau du signifiant (écho sonore en « eu » qui prolonge phoniquement la rime, paronomase sur « pleure »/« pleut ", reprise d’un mot particulier « cœur »...), l’interrogation dans laquelle le message se réfléchit pour donner à cette chanson triste un grand pouvoir mnémotechnique.
tangibles
Les fonctions du langage dans l’analyse littéraire. La finalité de l’explication de texte est principalement de commenter, avec une .terminologie précise, la fonction poyti y ue cl u 1 an gage par quoi tout texte signale son caractère littéraire. L’élément, princ,peS iN
Séiente's fonctions du^a;"Sjf ^dCtextè, d'en définir l.r
<*» lt! o,i'n'*"on'
aisunctes-
CE QUE L'ON EST SUPPOSÉ CONNAITRE
A. LES CONNAISSANCES À MOBILISER
a. Une langue à découvrir
'J "’y * jamais d'usage innocent de la langue : on s’étonnera dor ·
ZrU aVCC pr0hl; r ]'USa^ * tl*l ou tel terme, traqué néologisme comme 1 hapax".
Lne langue qui n’est pas neuve, lusou’i I-, , i
mondiale, période à partir de laquelle va se développer un en soi" f I n!i,dcr,iequi ne privilégieplus les langues classiques ,·
les humanités la plupart des écrivains et des Iccteu^E gardent avec les langues grecque e, latine une grande coinpli-
'cÎT déTTe' Ô nUit effr°yûble 0Ü "·«*· -oui o coup comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle Madame se meurt. Madame est morte i »
(Bossuet, Oraison funèbre d’Henriette d'Angleterre !
Le verbe étonner est ici encore très proche de son ctvmon latin №■ I un populaire- WMOT, du latin classique nttonlre an
" Pour bannir I ennemi dont ( étais idolâtre J affectai (es chagrins d'une injuste marâtre. »
(Racine, Phèdre acte I, sc. m )
L’attention à la langue du xvu siècle reconnaît sous le pluriel de « chagrins - non pas le sens courant et moderne d’« éta m r j
îSStSST:mais ferrmitTd’·
le cotcxtc (« maratre ») indique cette resémantisation.
El il se reconnut ou bord des quais »
(Haubert, L'Education sentimentale première port,e chap v.)
Le verbe <■ se reconnaître » est à comprendre à la fois comme N acuité de reconnaître les lieux, l’endÎoit ou son ^eTm né
émo,ioC’ ” ^ " ' r£r0UVCr 50,1 identi* hrouillée par une vive
O n causée par la rencontre avec M1”' Arnoux.
prêter attention aux « petits - mot..
« Moi. si fout-il mourir, et la vie orgueilleuse .
Qui brave de la mort, sentira ses fureurs. »
(Sponde, Essai de quelques poèmes chrétiens. senne ,
.. r„. disa„ Je me souviens d avoir été malade aussi a Pans
r»"'*' *w r«*fc*rr
dé»»... e"*lS™,.;c„d*ci,op
. ,1X extraits deux . petits » mots doivent retenir DanS Ca; c tion : Si », dans la langue du xvT siècle, n’ouvre " „ hvpothcsc mais émet plutôt un rapport adversaut
;U'CU n mndis que le « et » chez Voltaire traduit avec ironie
rspss** * «*■*- -
coordination.
b Le double héritage de la culture occidentale
Bien plus il faut considérer avec soin que la littérature rança.se
trouve sa source vive dans deux traditions qui nés«cl uent F-
l'ime l’autre mais souvent se joignent et s éclairent . ce .
d'une pan la tradition gréco-latine, dont les
avec d’importants corpus littéraires d autre par a tra* on
judéo-chrétienne. La connaissance de ces oripnu ^M
toire. La littérature ne se comprend que par ce '
déformé de ces voix, voies anciennes mais tou,ours emprume^
• I es textes fondateurs. Les grands textes antiques ne doivent
* » r ·_ n. ont hreement contribué a transmettre
LCommentaire composé et explication de texte 2
b· Des modèles de construction 14
e. LE REFUS BE L'EXCLUSIVITÉ SÉMANTIQUE 16
b. Les fonctions de la communication 18
LES SYNTHÈSES INDISPENSABLES 37
xv.»-‘lèele, 39
T e marivaudage 39
B. L'APPARTENANCE GÉNÉRIQUE 43
C. LES SÉQUENCES 44
b. La séquence narrative 47
d. La séquence argumentative 50
CARACTERISER 53
a* L'énonciation 53
c. Les modalités 57
d. Les modalisateurs 57
B ♦ LA FOCALISATION 57
a. Définition 57
b. Focalisation externe 57
c. Focalisation interne 58
d. Focalisation zéro 59
a. Définition 59
b. Repérage 59
. up$ tïXICAUX A· É A M P S SÉMANTIQUES 1
a Champ sémantique 1
b. Champ lexical 1
B. DÉTERMINATION ET CARACTÉRISATION 4
a. Détermination 4
b. Caractérisation 4
o. la chronologie 1
b. Les temps verbaux 1
OUTILS SYNTAXIQUES 1
d. L'incise 1
e. L'apostrophe 1
B. LA PHRASE SIMPLE ET LA PHRASE 1
COMPLEXE 1
es. La phrase simple 1
d. Cette construction symétrique met en valeur une opposition d’idées; deux termes antithétiques, le bien et le mal, se trouvent ainsi réunis dans un rapport de grande proximité puisque cha cun peut mener à l’autre.Suppression 1
QUELQUES OUTILS STYLISTIQUES 1
A. LES TROPES 1
C. LES FIGURES DE MISE EN VALEUR 1
CONSTRUIRE UNE INTERPRÉTATION 1
a. Reconnaître la difficulté 1
B. SÉLECTIONNER 2
LA PRESENTATION DU COMMENTAIRE COMPOSÉ 3
A. LES RÈGLES FORMELLES 3
a. Rendre visibles les articulations du devoir 3
b. Les titres 3
L'INTRODUCTION 9
a. Introduire le commentaire composé 9
destin d’Aurclien.UN EXEMPLE DE COMMENTAIRE COMPOSÉ 18
ABYME (MISE EN) 25
COTEXTE 25
HAPAX 25
HYPOTYPOSE 25
«ÉTATEXTE 25
NARRATAIRE 25
CONSEILS DE LECTURE 27
pfrehemm manant sur lequel on a effacé la première écriture afin de pouvoir écrire un nouveau texte.Lexiques 27
Dictionnaires 27
Culture générale .. 27
Un mot, el je reste avec toi Un seul mol, est-rl si difficile à dire 2 seul mot et je reste avec toi.
(Silence. Le vice-ro, baisse la tête et pleure Doňo Prouhèze s'es, voilee de la tête aux pieds.)
L'enpant (criant tout à coup) - Mère, ne m'abandonne pas !
(Une longue barque aux deux rangées de rameurs sans visage s vient se mêler au vaisseau imaginaire Deux esclaves noirs en soient gui la prennent sous les bras et l'emportent sous le funéb-» esquif.)
L'EnEant /avec un cri perçant). - Mère, ne m'abandonne pas' Mere, ne m abandonne pas I
iClaudei, Le Soulier de satin, troisième journée, sc. x„. ;
la est reprise de façon très précise une des sept paroles du Christ en croix (« EH, Eli, lana sabachtani » [Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?], Matthieu 27, 46, Marc 15, 34)| Tentant est ici abandonné par la mère tandis que le discours de dona Prouheze au vice-roi (. Un seul mot ») reprend le rituel catholique de 1 Eucharistie : « Dis une seule parole et je serai guen. » Le tragique de la scène se lit bien dans cette perspective religieuse d une séparation aggravée par l’absence d’une parole de réconfort, de partage.
• Étroite correspondance des sources chrétiennes et antiques.
« Dans le chaos d'une avalanche, deux pierres s'épousant au bond purent s aimer nues dans l'espace. L'eau de neige qui les engloutit s étonna de leur mousse ardente
L homme fut sûrement le vœu le plus fou des ténèbres; c'est
pourquoi nous sommes ténébreux, envieux et fous sous le puissani soleil »
(Char, ta Parole en archipel.)
Ce poème ou l’entreprise poétique vise à donner force et cohérence a la parole en archipel représente le salut de l’homme, la seconde création divine, ici créateur recréé par le pouvoir de la langue; et I on distingue parfaitement les textes-sources :
« Au commencement, Dieu créo le ciel et la terre Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux Dieu dit : "Que la lumière soit", et lalumière fut. Dieu vil que la lumière était bonne, et Dieu sépara la 3 1 „.lire et les ténèbres, »
lu (LoGenèse 1,1-4, Bible de Jérusalem.)
lusaue-là en effet, la discorde des éléments avait tout mêlé dis- tances, directions, liens, pesanteurs forces de choc, rencontres et mouvements, ce n était entre eux qu une mêlée générale, a cause de la dissemblance de leurs formes et de la variété de leurs fiaures · car. s’ils se joignaient tous ne pouvaient rester unis ou b^n accomplir ensemble les mouvements convenables. Mais alors de la terre se distingua la voûte du ciel à port la mer s etend.t dans son lit. à part aussi brillèrent les feux purs de l’éther »
(Lucrèce, De natura terum, V.)
c. Les mythes
Si le mythe est. selon c. Lév i-Strauss, l'instrument qui permet » une collectivité de résoudre une question insoluble les auteurs de l'Antiquité ont tenté de nous transmettre nombre de solutions, si nombreuses même qu’elles en deviennent a leur tout sujets de questionnement. Le mythe peut sc définir comme un récit fabuleux transmis par la tradition orale, qui met en scène des êtres exceptionnels incarnant des forces naturelles et différents aspects de la condition humaine.
Les mythes antiques. La littérature antique propose a notre imaginaire différentes versions d une même intrigue, remania ·> c à l'infini : les mvthes des cinq ages (le premier étant 1 age d or - voir Ovide, Les MttcimorphoiCi), d’Œdipe, d'Orphée, de Prométhée, de Pandore, sont à rechercher dans le panthéisme antique, le mvthe de Psyché dans L'Ane <1 or d Apulée.
Les mythes et l’intertextualité. La Bible offre des reçus qui se retrouvent dans d’autres religions (le récit du Déluge pat exemple), tandis que l’écrivain argentin J. L. Boiges, t„n> Fictions, s'interroge encore au x V siècle sur le mythe biblique de
,
la tour de Babel.
I-e mythe celte du Graal nourrii, quant à lui, de sa seve une grande partie de la littérature médiévale.
• Philosophie
et mythe. Une première lecture de ce sonnet de Joachim du Bellay dans L’Olive est assez déconcertante.< Si notre vie est moins qu'une journée En I éternel, si l'on qui fait le tour Chasse nos jours sans espoir de retour,
Si périssable est toute chose née,
Que songes-tu, mon âme emprisonnée?
Pourquoi le plaît l'obscur de notre jour,
Si pour voler en un plus clair séjour,
Tu as au dos l'aile bien empannée ?
Là, est le bien où tout esprit désire,
Là, le repos où tout le monde aspire,
Là, est I amour, là, le plaisir encore.
Là, mon âme, au plus haut ciel guidée !
Tu y pourras reconnaître l'Idée De la beauté, qu'en ce monde j'adore. »
Platon est en effet la figure maîtresse des humanistes, et ce poème ne peut se comprendre sans la référence aux trois mythes philosophiques exposés dans Le Banquet, Phèdre et La République: letre humain est coupé en deux et chaque moitié recherche sa part jumelle; de même, l’âme humaine est semblable à un char ailé tiré par deux chevaux, l’un blanc, attiré vers le ciel et I idéal, l’autre noir, attiré vers la terre et les plaisirs de la chair; enfin, I être humain est prisonnier d’une caverne, ne connaît pas la lumière du jour, et prend pour le soleil un feu allumé derrière lui et pour réelles les ombres projetées sur les parois de la grotte. Ainsi les grands textes de la philosophie ne doivent pas être négligés par les étudiants de lettres.
• Une lecture moderne du mythe. Tl est en effet attendu qu une connaissance précise, vérifiée à la source, se substitue aux nombreuses impropriétés et approximations du langage commun. Le passage suivant de Freud fixe ainsi l’analyse du mythe d Œdipe par le père de la psychanalyse :
« Sa destinée nous émeut parce quelle aurait pu être la nôtre parce qu à notre naissance l'oracle a prononcé contre nous cette meme malédiction. Il se peut que nous ayons tous senti à l'égard de notre mère notre première impulsion sexuelle, à l'égard de notre père notre première haine. nos rêves en témoignent. Œdipe qui tue son père et épouse sa mère, ne fait qu'accomplir un des désirs de notre enfance. Mais, plus heureux que lui, nous avons pu, depuis lors, dons la mesure où nous ne sommes pas devenus névropathes, détacher de notre mère nos désirs sexuels et oublier notre jalousie à I egard de notre père Nous nous épouvantons à la vue de celui qui a accompli le souhait de notre enfance, et notre épouvante a toute la force du refoulement qui depuis lors s'est exercé contre ces désirs. Le poète, en dévoilant la faute d'Œdipe,
nous oblige à regarder en nous-mêmes et 6 y reconnaître ces 3 impulsions qui. bien que réprimées, existent toujours. »
(Freud, L'Interprétation des rêves, trad. I. Meyerson.)
» LE TEXTE DANS L'INTERTEXTE B - *■
a. Le texte comme palimpseste*
Au-delà de la mobilisation inévitable d'un héritage culturel commun, il s’agit de repérer dans le texte les traces d'intertextualité. La lecture doit se comprendre comme un voyage vers
l’origine, quelle qu’elle soit.
La partie et le tout. Toute œuvre littéraire est aussi un discours direct ou indirect sur la littérature, et ici le fragment, le texte objet de l’explication et la totalité de l’oeuvre s'éclairent mutuellement.
L’« innutrition ». 1 e texte ne peuple .réjjlliK'ij^^
■inn purement technique. La connaissance d’un certain nombre d’ouvrages est fondamentale et aucun manuel ne peut vous éviter de lire, il s’agit de pratiquer cette « innutrition » chère à Montaigne, la fréquentation de grands textes qui permet de saisir le sens de l’histoire littéraire, conçue comme partie intégrante de la culture nécessaire à toute lecture critique sérieuse. Le texte littéraire exige toujours de rencontrer des compétences culturelles, psychologiques et linguistiques qui seules pet mettront d’« entendre » ce qui n’est que suggéré ou disséminé dans le texte. «Je crois en vérité que nos pères ont trop lu ». disait Valéry. Trop, peut-être pas, mais tous ses pairs et lui le premiet définissent leur activité d’écrire comme consubstantielle a leur activ its de lire.
b. Un exemple magistral : l'incipit d'Aurélien
Le texte de Louis Aragon s’inscrit à merveille dans cette perspective d’une littérature conçue comme un espace de icncontics.
«Lo première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il ia trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orienl sans avoir loir de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux cou pés, ça demande des soins constants. Aurélien n aurait pas pudire si elle élan blonde ou brune II l'avait mal regardée II lu, Sr demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation” I se demanda même pourquoi C était disproportionné. P|utè, petite, pâle je crois Quelle se fût appelée Jeanne ou Marie n'y aurait pas repensé, après coup. Mais Bérénice Drôle de super. stition. Voilà bien ce qui l'irritait.
J
If y avait un vers de Racine que ça lu, remettait dans la tête, un ver, qui I avait hanté pendant la guerre, dans les tranchées, et plu, tard démobilisé. Un vers qu'il ne trouvait même pas un beau vers ou enfin dont la beauté lui semblait douteuse , inexplicable, mai, qui I avait obsédé, qu, l'obsédait encore :
e demeurai longtemps eirant dans Césaréefin général, les vers, lui... Mais celui-ci revenait et revenait Pourquoi ? c'est ce qu'il ne s'expliquait pas Tout à fait indépendamment de I histoire de Bérénice .. l'outre, la vraie... D'ailleurs il ne se rappelait que dans ses grandes lignes cette romance, cette scie. »
La subversion d’un topos. Ce texte d’Aragon ne peut se comprendre que dans sa réference obligée à la tragédie de Racine qui n est précisée que de manière indirecte («un vers de Racine »). Or des le début, la subversion du topos de la rencontre amoureuse se donne à lire par le rapprochement, dans la temporelle initiale, des noms Bérénice et Aurélien, associés par eur connotation noble. Aurclicn n’est pas Titus, celui qu’aime heroïne racmienne, mais son prénom latin rappelle celui des
plus grands empereurs (Vespasien, Hadrien...).
L intertexte racinien. La référence très précise à la « prin cesse d’Orient » souligne la très bonne connaissance qu’a Aurehen de ce qu’il appellera les « grandes lignes » de la tragédie. C’est bien parce qu’Aurélien, dès la première rencontre avec
crénice, pose le lexte de Racine comme un objet sur lequel le sentiment peut se porter, que ce prénom déclenche la rêverie propice à I éclosion du sentiment amoureux.
Une fin déjà connue. Bien plus encore, le lecteur cultivé qu. aura reconnu le « collage » du vers 235 de la tragédie de Racine comprendra alors que l’échec de cette relation amoureuse est déjà programme. C est en effet Antiochus, l’amant malheureux de
eremee, celui qui sait dès le premier acte que son amour est condamne, qui prononce ce vers. La fonction de l’intcrtexte est capitale. Il peut susciter la curiosité du lecteur : l’œuvre Aragon serait-elle la version moderne et romanesque de Béré-
, Qu plus subtilement, l’intertexte convoqué des i'inapn ' ;it.il pas d’emblcc le roman vers une interrogation su. " ÎÏérature et ses pouvoirs s, magiques qu’ils en arrivent à faire *â 1nclre une héroïne de tragédie pour « I autre, la vraie... » i
„
pre
ES « LIEUX » à FRÉQUENTERC ·
Les lieux communs
.-origine, le lieu commun est un terme de rhétorique. Aux vvP et XVIIe siècles, les écrivains français recourent massivement , es Heux communs, les topoï(pluriel du grec topos, heu). Cette littérature faite de reprises suppose évidemment une forte connivence culturelle, ces lieux étant partagés par la communauté lecteurs-auteurs. Dresser un inventaire de ces heux (- une topique) est inutile. Encore une fois, c’est la fréquentation assidue des lieux communs aux écrivains d’une époque qui permet
de les reconnaître comme un paysage déjà vu.
Quelques lieux ou types fréquents. La littérature médiévale
reprend les grands types de la littérature antique (la lemt, ou hideuse vieille dans le théâtre latin, le combat contre e monstre...), et va développer celui du faux inconnu qui permet d’entretenir un réservoir de lieux communs sur le theairum ni un J i et le thème du déguisement. La littérature baroque jouera sur les oppositions vieillard-enfant, jeune-vieille femme, a vanité du monde, le miroir ou la fenêtre, qui permettent de dérouler le thème du monde renversé,
Le locus amoenus est un lieu agréable, idéal, champêtre, où dominent fontaines et ruisseaux.
« Les doux zéphyrs conservaient en ce heu, malgré les ardeurs du soleil, une délicieuse fraîcheur. Des fontaines, coulant avec un doux murmure, sur des prés semés d'amarantes et de violettes, for- maient en divers lieux des bains aussi purs et aussi clairs que le cristal, mille fleurs émaillajent les lapis verts dont la grotte était environnée. »
(Fénelon. Les Aventures de Télémaque livre premier.)cée de senfiers tortueux, - et le Morimont grouillant de capes, chapeaux.»
(Bertrand, Gaspard de la nuit, « Un rêve
La littérature romantique développera ses lieux communs ic. voyage, le clair de lune.
• Le cliché : on ne confondra pas le lieu commun avec le dicht qui est la formulation stéréotypée d’une expression.
« La verdure qui naît, l’oiseau qui chante, la fleur qui s’ouvre - par cette suite de clichés sur le printemps, Oberman, le héros éponyme* de Senancour, dénonce l’artifice de cotte saison et réaffirme sa prédilection pour l’automne.
Les synthèses littéraires
Afin de se constituer des repères précis sur différents thèmes er courants de la littérature, on peut, à l’aide d’anthologies, récapituler l’état des connaissances sur des fiches synthétiques.
_____ - _ |
LES SYNTHÈSES INDISPENSABLES
Moyen Age et xvi* siècle
L’allégorie > ,
Fin’amor et courtoisie Le récit médiéval
La * grande rhétorique » (XVe siècle) : triomphe de la poé- 1 sie formelle , v
Le platonisme à la Renaissance Le sonnet
La conception de l’homme : de l’humanisme à Montaigne
xvii" siècle
La poésie baroque
Le langage et les genres de la Préciosité Le jansénisme
Théorie et genèse du classicisme
La tragédie grecque
L’héroïsme cornélien
Le héros tragique chez Racine
La comédie de Molière
A la recherche du romanesque
Les
genres mondains : lettres, maximes, mémoires5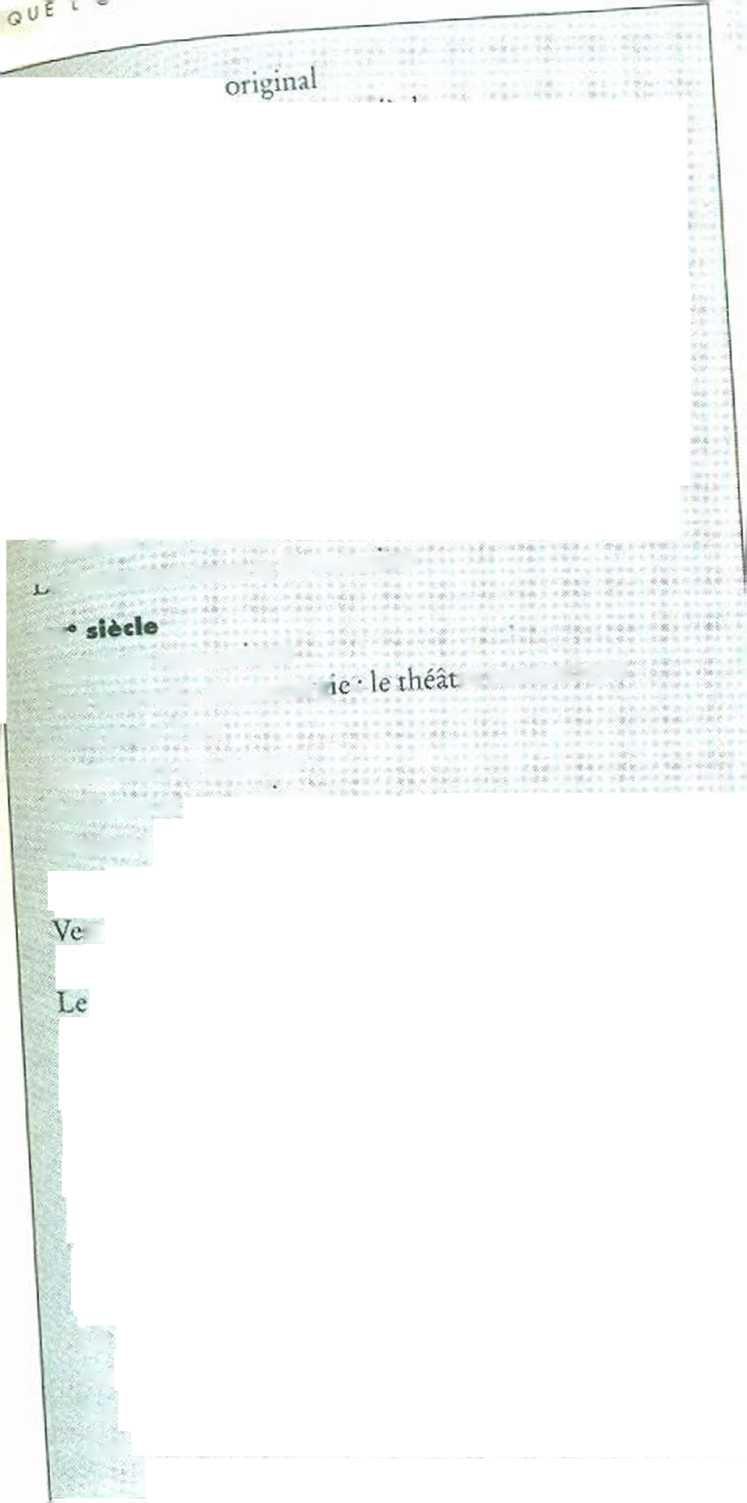 Ê
CONNAÎTRE
Ê
CONNAÎTRE
xv.»-‘lèele,
T e marivaudage
ζΖΖΖΓ» ~m»n ¥«»'“"1 h
ψ- en cause du roman ; , . „ ;v
Évolution de la comedie Littérature et musique 'a littérature sous la Révolution
χίλ
La poésie romantique ^ romantique
Une nouvelle dramatuig -*
L’art pour l’art Littérature et sciences
Réalisme et naturalisme -
Symbole et symbolisme
"„№«»«> lite «.aa»·*·***'1*
L’inspiration mythologique dans le theat,
XXe siècle
Le nouveau roman et le soupçon
U absurde i* ■ pr et scicnce-botion
Littératures particulières : roman policier et
Les littératures francophones
Notions qui traversent les époques
La description Le poème en prose
Autobiographie et Mémoires Le personnage dans le roman Les grandes doctrines esthétiques
SITUER LE TEXTE DANS L'ŒUVRE
A· ÎSXTi ET CONTEXTE
a. Le contexte
Le morceau choisi n’cst pas un espace textuel de génération spontanée, venu au monde pour naître, vivre et mourir dans uoc- anthologie. II fait partie d’une œuvre au sens large, Popus de tel écrivain, et s inscrit donc dans une somme, en est un «morceau » qui ne se conçoit que dans le rapport étroit à l’ensemble dont il est issu. .Mais, paradoxe ou vertige qui fait le sel de l’exercice, il doit lui aussi être traité avec les égards réservés à l’œuvre, en e à son tour considéré comme un tout, un espace clos dont les frontières se justifient - comme par magic - d’ellcs-mêmcs.
• Autour de l’œuvre. Tout d’abord il faut situer le texte dans son environnement économique, historique et littéraire (c’est ■ affaire de 1 intertextualité mais aussi de la production d’une époque). Ainsi, Bérénice, tragédie de Racine, est représentée le 21 novembre 1670. Une semaine plus tard, la troupe de Molière donnait la comédie héroïque de Corneille Tite et Bérénice. Quelle pièce la postérité a-t-elle reconnu ? Et pourquoi ? Bérénice :
c est d’abord un produit de Pair du temps, la reconversion du romanesque courtois, L'Astrêe, les jeux des salons, célèbres sous le nom « Questions d’amour » ;
c est sans doute aussi le vainqueur du duel littéraire peut-être provoqué par Henriette d’Angleterre, belle-sœur de Louis XIV, entre Racine et Corneille ;
c est surtout la possibilité pour Racine d’explorer et de fixer sa manière propre, d’atteindre sa valeur distincte qui le place en position prépondérante chez les dramaturges, quand la tragédie épurée touche au sublime du sentiment et non plus à la galante rie du schéma pastoral ;
c est enfin et rétrospectivement la définition la plus pure de la tragédie française classique à l’aune de laquelle sera évaluée toute la production future en référence aux propos de Racine lui-même :
« Il y en a qui pensent que cette simplicité est une marque de peu d'invention. Ils ne songent pas qu'au contraire toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien, et que fout ce grand nombre d'incidents a toujours été le refuge des poètes qui ne s
e. I F TEXTE DANS l'CEUVRE 27
SITUE*
taient pas dans leur génie ni assez d'abondance ni assez de ^ force pour attacher durant cinq actes leurs spectateurs par une action simple, soutenue de la violence des passions, de la beauté des sentiments et de l'élégance de l'expression. »
(Racine, Préface de Bérénice.)
’œuvre ne peut donc être distinguée des institutions qui auto- 'sent et favorisent sa création, et le recours à la sociologie litté- n ;re permet d’apprécier le rôle des règles de 1 art.
Iâ L’œuvre et le temps. Ensuite, on doit prendre en compte la Réception d’une œuvre à une époque ou à l’épreuve du temps.
Ce jugement de Chateaubriand apporte à l’analyse de René un éclairage intéressant puisque l’auteur en personne dénonce le cliché qu’est devenue l’expression romantique des sentiments de son personnage.
« Si René n'existait pas, je ne l'écrirais plus ; s il m était possible de le détruire, je le détruirais. Une famille de René poètes et de René prosateurs a pullulé; on n'a plus entendu que des phrases lamentables et décousues; il n'a plus été question que de vents, d'orages, que de maux inconnus livrés aux nuages et à la nuit. » [Mémoires d'outre-tombe, livre XIII, chap. x.)
$ Un équilibre nécessaire. C’est la trame complexe des rapports entre l’œuvre et la vie de l’auteur qui doit être étudiée ici.
La question de savoir quelle part il faut réserver à l’une ou à l’autre n’a pas de réponse. Tout est affaire de mesure.
De même, nul ne peut dire s’il faut aimer, respecter l’écrivain pour apprécier l’œuvre. En effet, rien ne doit gêner 1 objectivité préalable à toute investigation littéraire. Le lecteur est un enquê- teur qui rassemble des indices, il n’a pas à prononcer de verdict.
b. Le plece de l'extroit étudié dans l'ouvrage
Le texte doit être situé dans l’oeuvre, puis dans 1 ouvrage dont il est extrait. Le paratexte doit faire l’objet d’une grande attention : toutes les préfaces, dédicaces, épigraphes, les titres et sous- titres doivent être expliqués. Le traitement d un incipit, d une fin de roman, d’une scène d’exposition ou de dénouement requiert une attention particulière. De même, 1 insertion d un portrait, d’une conversation dans une trame narrative, fait sens.
Dans un texte théâtral, la disposition des personnages est importante, la place de la scène dans l’acte et dans la pièce est importante; dans un recueil de poésie, la structure aussi est fonda-mentale. Si Rimbaud n’a jamais réuni ses poèmes, ceux-ci son* pourtant classés dans un ordre qui lente de suivre la chronologie de leur composition. L explication de texte suppose alo:\ plusieurs lectures, rétroactive et prospective, qui tiennent compte de la place du texte.
B. L'APPARTENANCE GÉNÉRIQUE
Le genre
fout texte pose le problème de la reconnaissance par le lecteur du genre auquel il appartient. C’est le premier réflexe : deman der sa « cane d'identitc» au texte. Le genre peut se définir comme une categorie littéraire qui permet de regrouper un certain nombre de textes selon des critères variables. Depuis Aristote et sa Poétique, on distingue trois grands genres : épique, lyrique ci dramatique. Ils correspondent aux grandes formes que reconnaît immédiatement la conscience naïve du lecteur : ia liccion narrative, la poésie (vers ou prose), le théâtre. On peut ajouter une quatrième forme: l’essai, souvent défini par défaut.
La reconnaissance du genre
Le nombre de critères pour définir un genre varie de Lun ;
1 autre. Sont prises en compte les différences de structure, de mode dénonciation, de formes d’interventions de l’auteur. Si. depuis Aristote, la tragédie est définie en fonction de critères précis, le roman, protéiforme, est difficile à cerner.
Les critères de reconnaissance ont évolué selon les époques, t >n différencie les trois grands genres tantôt selon leur mode de transmission et l’interprétation qui en découle (le fait de chanter, de raconter ou de jouer), tantôt selon des critères historiques, tantôt selon des critères rhétoriques (la distinction porte sur les modes d’enonciation).
Chacun de ccs « archi-genres » contient un certain nombre de sous-genres (ex. : le roman policier, d’anticipation...).
Être en teri ain familier. I intérêt de la reconnaissance générique est double : elle suscite une attente du lecteur, qui va programmer sa lecture selon sa familiarité avec le genre, et elle es: l'occasion d'un dialogue intertextuel, chaque œuvre devant trouver sa place dans sa famille générique. De fait, un genre n’existe et ne sc définit que par rapport aux autres, sa définition ressortit précisément a l'tntcriexiualité.,lFolE TEXTE DANS L'ŒUVRE 2V
s ï T u tK
Ordre et mouvement. Toute taxinomie d’ailleurs implique
hiérarchie ; or l’histoire littéraire se comprend aussi comme Mutte contre une forme dominante, pour le droit des genres Prioritaires (ce que fut pendant longtemps le roman) à exister. Fnfifl, ^es ca^res traditionnels ne peuvent contenir les différentes formes de création qui font précisément de la subversion du modèle un principe fondateur.
Les œuvres inclassables. Reste alors le problème des œuvres ouvertes non réductibles à une classification générique. Que faire par exemple du Neveu de Rameau : un roman, une pièce de théâtre, un pamphlet philosophique ? Cette indétermination est constitutive de cet ouvrage et participe pour beaucoup au plaisir de sa lecture.
C. LES SÉQUENCES
La reconnaissance de la cohérence d'un texte tient en grande part aux types de séquences (notion introduite par J.-M. Adam) que Ton peut distinguer en analysant un texte et qui sont transversaux aux genres littéraires.
Définition de la séquence
Reconnaître le type du texte étudié permet souvent d’orienter fructueusement la recherche. Il existe un petit nombre de types séquentiels fondamentaux, proches de la reconnaissance spontanée opérée par le lecteur : les plus évidents sont la narration, la description, l’argumentation.
Dans un même texte, on peut trouver diverses séquences emboîtées scion un mode d’insertion particulier: par exemple, une description dans une argumentation, une argumentation dans une narration... En bref, un texte est une structure hiérarchique complexe comprenant n séquences - elliptiques ou complètes - de même type ou de types différents.
Le texte comme réalité hétérogène. Un même texte peut, mais c’est rare, n’être composé que d’une seule séquence. Il peut comporter différentes séquences de même type, susceptibles alors d‘être coordonnées les unes aux autres ou insérées dans une séquence principale.
L’insertion de séquence. Dans ce cas, ce qui retient 1 intérêt est le marquage des zones frontières, des lieux initial et tinal ^'insertion.
u COMMENTAIRE C C M P -
° t
«Un jour, en revenant de sa fournée, ce malicieux ef viciée* vieillard aperçut une petite fille ravissante au bord des proirli; dans I avenue de Tivoli Au bruit du cheval, l'enfant se dressa ± *ond d'un des ruisseaux qui, vus du haut dTssoudun, ressembler a des rubans d argent au milieu d'une robe verte. Semblable à une naïade, la petite montra soudain au docteur une des plus belles fêtes de Vierge que jamais un peintre ait pu rêver. Le vieux Rouget qui connaissait tout ie pays, ne connaissait pas ce miracle de beauté La fille, quasi nue, portait une méchante jupe courte trouée et déchiquetée, en mauvaise étoffe de laine alternativement rayée de bistre ef de blanc. Une feuille de gros papier attachée par brin d'osier lui servait de coiffure. Dessous ce papier plein ds bâtons et d O, qui justifiait bien son nom de papier écolier, était tordue et rattachée, par un peigne à peigner la queue des chevaux, ia plus belle chevelure blonde quait pu souhaiter une fi!,e d Eve. [.. ) Enfin, cette nymphe avait des yeux bleus garnis de ci's dont le regard eût fait tomber a genoux un peintre et un poète Le médecin, assez anctomiste pour reconnaître une taille délicieuse, comprit tout ce que les arts perdraient si ce charmant modèle se détruisait au travail des champs.
' u es'tu' ma petite 2 Je ne f ai jamais vue, dit le vieux médecin alors âgé de soixante-dix ans. »
(Balzac, La Rabouilleuse
a scquencc narrative, déclenchée par « Un jour » s’interrompt à « lin racle de beauté ». L'hyperbole prépare la séquence de>- ci iptiv e, de même que la répétition du verbe « connaissait » i prenne.* \ erbe à 1 imparfait dans le passage) accentue la rupture avec le passé simple. Le portrait se déroule ensuite jusqu’à l’hvpcr bole finale « fait tomber à genoux un peintre ou un poète. ». La narration se trouve alors relancée par le retour sur l’observateur, le médecin, et à l'emploi du passe simple (« comprit »).
• Un marquage brouillé.
« Ses yeux, délaissant à gauche le ponf de pierre de Notre-Dame et trois ponts suspendus, se dirigeaient toujours vers le quai aux Ormes, sur un massif de vieux arbres, pareils aux tilleuls du port de Montereau La tour Saint-Jacques, f'HÔfel-de-Ville, Saint-Gervais Samt-Louis, Saint-Paul se levaient en face, parmi les toits confondus - et le génie de la colonne de Juillet resplendissait à I orient comme une large étoile d or. tandis qu à l'autre extrémité le dôme des Tui· ferles arrondissait, sur le ciel, sa lourde masse bleue. C'était par derrière, de ce côte-là, que devait être la maison de MT* Arnoux
. ,ç TEXTE DANS L'ŒUVRE 3 1
$|T^R
K rentrait dans sa chambre; puis, couché sur son divan, s abandonnait à une méditation désordonnée ; plans d'ouvrages, projets de conduite, élancements vers l'avenir. Enfin, pour se débarrasser de lui-même, il sortait.
|| remontait, au hasard, le quartier latin, si tumultueux d habitude, mais désert à cette époque, car les étudiants étaient partis dans leur5 familles. Les grands murs des collèges, comme allongés par le silence avaient un aspect plus morne encore; on entendait toutes sortes de bruits paisibles, des battements d'ailes dans les cages, le ronflement d'un tour, le marteau d'un savetier ; et les marchands d'habits, au milieu des rues, interrogeaient de l'œil chaque fenêtre, inutilement. »
(Flaubert, L'Éducation sentimentale, première partie, chap. v )
Cet extrait montre comment les séquences narrative et descriptive vont se fondre dans une indistinction qui rend compte de l’état de vacance(s) dans lequel se trouve Frédéric Moreau, précisé juste avant par « Alors commencèrent trois mois d’ennui. ». Le thème du regard (« Ses yeux [...] se dirigeaient ») amorce de façon traditionnelle la description qui laisse à ce moment-là la place à la séquence narrative qui recommence à « C’était par derrière, de ce côté-la, que devait être la maison de Mmc Arnoux. ». L’irruption du nom de la femme aimée reprend le fil d’une histoire d’amour impossible tandis que le paragraphe suivant décrit, grâce à l’énumération (« plans [...] l’avenir. »), les projets avortés de Frédéric. Avec l’expression « quartier latin » est relancée la description, cette fois accompagnée d’un mouvement ; elle prolonge également révocation de l’ennui d un Paris déserté.
