
- •Chimie bioorganique sous forme « question-réponse »
- •Tambov 2013
- •Sommaire
- •Introduction
- •1. Classification et nomenclature des composés organiques biologiquement importants
- •2. Constitution des composés organiques
- •3. Principes généraux de la capacité réactionnelle des composés organiques
- •4. Acides aminés, peptides, protéines
- •5. Glucides : mono-, di- et polysaccharides
- •6. Les nucléotides et les acides nucléiques
- •7. Les lipides et les biorégulateurs micromoléculaires
- •8. Identification des composés organiques
6. Les nucléotides et les acides nucléiques
Question 86. Quels composés sont les monomères des acides nucléiques ?
Réponse. Les acides nucléiques (les polynucléotides) – sont les polymères biologiques, dont les chaînons sont présentés par des nucléotides.
Le nucléotide – ce n’est pas le composé individuel, il se compose du nucléoside et du reste de l’acide phosphorique.
Le nucléoside – ce n’est pas le composé individuel, il se forme en cas d’intéraction du glucide (du ribose ou du désoxyribose) et de la base hétérocyclique.
Question 87. En quelle forme les glucides font partie des acides nucléiques ?
Réponse. Le ribose en forme furanose cyclique – β-D-ribofuranose fait partie des molécules de l’ARN, les molécules de l’ADN contiennent le 2-désoxyribose en forme furanose – 2-désoxy-β-D-ribofuranose.
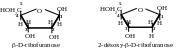
Question 88. Quelles bases hétérocycliques peuvent faire partie des acides nucléiques ?
Réponse. Les bases nucléiques – sont les dérivés des composés hétérocycliques contenant de l’azote – de la purine (l’adénine, la guanine) et de la pyrimidine – la thiamine (juste dans l’ADN), l’uracile (juste dans l’ARN) et la cytosine.

Question 89. En quoi consiste la différence des structures de l’ADN et de l’ARN ?
Réponse. L’ADN et l’ARN se diffèrent par le type du composant glucidique (le β-D-ribofuranose fait partie de l’ARN, le désoxy-β-D-ribofuranose fait partie de l’ADN) et par la composition des bases pyrimidiques (l’uracile et la cytosine font partie de l’ARN, la thimine et la cytosine font partie de l’ADN. L’ADN existe sous la forme du double spirale composé de deux molécules différentes. Les molécules de l’ARN sont souvent plus courtes et, comme en règle, unichaînées.
Question 90. Comment détérminer le type de liaison entre les fragments des acides nucléiques ?
R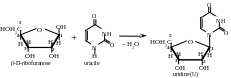 éponse.
Les acides nucléiques présentent les chaînes longue des monomères
– des nucléotides. Le nucléotide – est un composé qui se
compose du nucléotide et du reste de l’acide phosphorique, liés
l’un avec l’autre. Le nucléoside se forme suivant la réaction
entre le glucide (le ribose et le désoxyribose) et la base
hétérocyclique. C’est le groupe −NH− de la base
hétérocyclique et l’hydroxyle semi-acétal du glucide qui
interagissent. La liaison N-glycosidique se forme :
éponse.
Les acides nucléiques présentent les chaînes longue des monomères
– des nucléotides. Le nucléotide – est un composé qui se
compose du nucléotide et du reste de l’acide phosphorique, liés
l’un avec l’autre. Le nucléoside se forme suivant la réaction
entre le glucide (le ribose et le désoxyribose) et la base
hétérocyclique. C’est le groupe −NH− de la base
hétérocyclique et l’hydroxyle semi-acétal du glucide qui
interagissent. La liaison N-glycosidique se forme :
Dans les acides nucléiques le glucide est en forme β-D-furanose, c’est pourquoi la liaison s’appelle β-N-glycosidique. Les bases pyrimidiques et puriques forment ce type de liaison.
Ensuite le groupe hydroxylé alcoolique du nucléoside dans la position 5’ ou 3’ doit interagir avec l’acide phosphorique suivant la réaction de l’étherification. L’ester se forme, alors, on peut nommer cette liaison la liaison estérique. Comme l’acide phosphorique participe dans la formation de l’ester on peut nommer cette liaison la liaison phospho-estérique.
Quand les nucléotides se fixent l’un avec l’autre la réaction de l’étherification entre le reste de l’acide phosphorique du nucléotide et le groupe hydroxylé alcoolique du glucide en position 5’ ou 3’ se passe de nouveau. On peut dire que les nucléotides sont liés l’un avec l’autre par la liaison 3’5’-estérique ou phosphodiestérique.
En cas de formation de la structure secondaire (du double spirale) de l’ADN entre les bases hétérocycliques complémentaires les liaisons d’hydrogène, assurant l’existance de la structure spiralesque de la molécule, se forment.
Question 91. Qu’est-ce que c’est la structure primaire des acides nucléiques ?
Réponse. La structure primaire des acides nucléiques – est une composition de nucléotide et la séquence de nucléotide, c’est-à-dire, l’orde de l’alternance des chaînons de nucléotide dans la molécule de l’acide nucléique. On établit la composition de nucléotide, en examinant les produits de la décomposition hydrolytique des acides nucléiques.
L’ARN s’hydrolyse facilement dans des conditions douces au milieu alcalin jusqu’aux nucléotides qui sont capable à leur tour d’éliminer un reste de l’acide phosphorique avec la formation des nucléosides. Dans le milieu acide les nucléosides s’hydrolisent jusqu’aux bases hétérocycliques et jusqu’aux glucides.
On presque n’applique pas l’hydrolyse chimique de l’ADN à cause de sa complication par les processus secondaires. L’hydrolyse enzymatique sous l’action des nucléases est plus préféré.
Question 92. Qu’est-ce que c’est la structure secondaire de l’ADN ?
Réponse. La structure secondaire de l’ADN est une organisation spatiale de la chaîne polynucléotidique. Sa modèle a été proposé en 1953 par Watson et Crick. Selon cette modèle la molécule de l’ADN possède la forme du spirale tordé à droite, formé par deux chaînes polynucléotidiques, tordés un relativement à l’autre autour de l’axe commun. La modèle de l’ADN est présentée à la figure 6. La distance entre les tours de torsion (le pas du spirale) est égale à 3,4 nm. 10 restes nucléotidiques s’installent sur ce cite, la taille d’un nucléotide fait 0,34 nm ; le diamètre de la molécule bispiralesque fait 1,8 nm.

Figure 6. La présentation schématique du double-spirale de l’ADN : a – d’après Watson et Crick (с – le reste du désoxyribose, p – le reste de l’acide phosphorique) ; б – A-forme de l’ADN ; в – B-forme.
La configuration du double spirale de l’ADN change suivant le taux quantitatif de l’eau et de la force ionique de la solution. On a constaté l’existance de six formes de l’ADN, nommés les A-, B-, C-, D-, E- et Z-formes. La configuration de deux formes est présentée à la figure 6. Dans l’A-forme on observe le déplacement des paires des bases de l’axe de la molécule à la périphérie, ce qui est appréciable du côté des tailles (2,8 nm – la taille d’un tour de tortion qui contient 11 mononucléotides à la place de 10 ; la distance entre les nucléotides change). Les A- et B-formes présentent le double-spirale tordé à droite. La Z-forme (zigzagué) de l’ADN possède une configuration tordé à gauche, où le squelette phosphodiétherique s’installe en zigzag le long de l’axe de la molécule. On suppose que l’A-forme de l’ADN joue le rôle de la matrice au cours de la transcription (la synthèsede l’ARN sur la molécule de l’ADN), la B-forme – le rôle de la matrice au cours de la réplication (la synthèse de l’ADN sur la molécule de l’ADN).
Les restes des bases nucléiques sont dirigé au sein du spirale. La multiplicité des liaisons d’hydrogène se forment entre les bases azotées pour assurer la résistance maximale de cette structure. Ca arrive par la coordonnance particulière de l’installation des restes des bases d’un spirale par rapport aux restes de l’autre : les groupes de thymine d’un spirale s’installent contre les groupes d’adénine de l’autre (deux liaisons d’hydrogènes se forment entre eux), les groupes de cytisine – contre les groupes de guanine (trois liaisons d’hydrogènes se formesnt entre eux). Ces bases font des paires complémentaires. Les liaisons d’hydrogène se forment entre le groupe aminé d’une base et le groupe carbonylé de l’autre, entre les atomes amidiques et imidiques de l’azote.
Question 93. Qu’est-ce que c’est la structure tertiaire de l’ADN ?
Réponse. L’ADN forme les spirales dans les cellules, ce qui assure la compacité de son emballage. L’ADN de 4 sm se trouve dans le chromosome de 5 nm. La longueur de l’ADN s’accourcit en 100 milles fois. La structure tertiaire de l’ADN des eucaryotes se forme par la voie de l’intéraction avec les protéines nucléaires, et à l’étape particulier du cycle cellulaire elle prend la forme des chromosomes (fig. 7).

Figure 7. Le shéma de la formation de la structure tertiaire de l’ADN
Question 94. Qu’est-ce que c’est la structure secondaire de l’ARN ?
Réponse. La molécule de l’acide ribonucléique est construit par une chaîne polynucléotidique. Les cites particuliers de la chaîne de l’ARN forment les anses spiralisées – « les aiguilles » aux frais des liaisons d’hydrogène entre les bases complémentaires azotées l’adénine-uracile et la guanine-cytosine (fig.8). Dans telles structures spiralées les cites de la chaîne de l’ARN sont antiparallèles, mais pas toujours complémentaires absoluement, elles contiennent des restes nucléotidiques ou même les anses unichaînées qui ne s’installent pas dans le double-spirale. La présence des cites spiralisés est propre pour tout les types de l’ARN :
A |
B |
Figure 8. Le schéma de la formation de la structure secondaire de l’ARN : A – le schéma de la formation des liaisons entre les bases complémentaires ; B – le schéma de l’ARN de transport.
Les ARN de transport contiennent 4 cites spiralisés et 3, parfois 4, anses unichaînées (fig. 8). En cas de présentation de telle structure à la surface on reçoit la structure qui s’appelle « la feuille de trèfle ».
Question 95. Qu’est-ce que c’est la structure tertiaire de l’ARN ?
Réponse. Les ARN unichaînés se caractérisent par la structure tertiaire compacte et ordonnée, formée par la voie d’interaction des élements spiralisés de la structure secondaire. Ainsi, la formation des liaisons d’hydrogène supplémentaires entre les restes de nucléotides assez éloignés l’uns des autres, ou des liaisons entre les groupes OH des restes de ribose et les bases sont possibles. La structure tertiaire de l’ARN est stabilisée par des cations des métaux bivalents, par exemple, Mg2+. Ces cations s’associent non seulement aux groupes phosphates, mais aussi aux bases.
Question 96. Quelle base est complémentaire à la thymine ? Montrez la constitution de cette paire complémentaire et indiquez les liaisons d’hydrogène.
Réponse. L’adénine – est une base complémaintaire à la thymine. Deux liaisons d’hydrogène se forment entre eux.
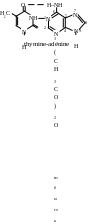
Question 97. Quelle base est complémentaire par rapport à la cytosine ? Montrez la constitution de cette paire complémentaire et indiquez les liaisons d’hydrogène.
Réponse. La guanine - est une base complémaintaire à la cytosine. Trois liaisons d’hydrogène se forment entre eux.

Q Réponse. Pour détérminer quel diopolymère est présenté à la figure, il faut analyser sa constitution. On voit le fragment de l’acide nucléique, composé de trois nucléotides.
|
Figure 9. Shéma du biopolymère
|
Le composant glucidique – est le ribose, car le groupe hydroxylé est présenté dans la position 2’. Conséquemment, c’est le fragment de l’ARN. C’est la structure primaire (la séquence des nucléotides dans la chaîne de l’acide nucléique). Mais le nucléotide supérieur contient la base hétérocyclique la thymine, mais pas l’uracile (il y a le groupe −CH3). Conséquemment, il y a une faute dans la présentation du fragment de l’ARN.
Question 99. Le fragment duquel biopolymère est présenté à la figure 10 ? Quelle structure du polymère est présentée (promaire, secondaire)? S’il y a des fautes dans la présentation de ce fragment ? Réponse. Pour détérminer quel diopolymère est présenté à la figure, il faut analyser sa constitution. On voit le fragment de l’acide nucléique, composé de trois nucléotides.
|
F
|
Le composant glucidique – est le désoxyribose, car le groupe hydroxylé est absent dans la position 2’. Conséquemment c’est un fragment de l’ADN. C’est la structure primaire (la séquence des nucléotides dans la chaîne de l’acide nucléique). Le nucléotide supérieur contient la base hétérocyclique la thymine (il y a le groupe −CH3). Conséquemment, il n’y a pas de fautes dans la présentation du fragment de l’ADN.
Question 100. Nommez les types de l’ARN.
Réponse. Il existe plusieurs types de l’ARN.
Les ARN ribosomiques (ARNr) font partie des ribosomes, présentent leur base structurelle. L’integrité de leur molécules est nécessaire pour la biosynthèse des protéines sur les ribosomes.
Le rôle biologique des ARN de transport (ARNt) consiste en association des restes d’acides aminés activés et en leur transport sur les ribosomes, c’est-à-dire, sur le site de synthèse des chaînes polypeptidiques.
Les ARN messagers ou matriciels (ARNm) jouent le rôle des matrices en cas de biosynthèse des protéines au cours de la traduction (la lecture du code nucléotidique et son transmission en séquence des acides aminés dans des chaînes polypeptidiques des protéines)
On discute l’intérêt de la distinction des certains autres tyoes de l’ARN : micromoléculaires (petits) nucléaires, antisémantiques, viraux.
Les ARN micromoléculaires nucléaires (ARNmn) – est une classe d’ARN présentée dans le noyau des eucariotes. Ils participent dans les processus importants, comme l’épissage (l’élimination des introns de l’ARNm immaturé), la régulation des facteurs de la transcription ou de l’ARN-polymérase et dans l’emtretion de l’integrité des télomères.
Les ARN antisémantiques – sont les ARN unichaînés, complémentaires à l’ARNm. On introduit des ARN antisémantiques dans les cellules pour l’inhibition de la traduction des ARNm complémentaires, parce que les ARN antisémantiques s’accouplent avec L’ARNm-cible et empêchent physiquement la formation du complexe de traduction. Cet effet est stoechiométrique.
Les ARN viraux – sont les composants des ribonucléoprotéines virales et phagiques, ils portent toute l’information nécessaire pour la multiplication des virus dans les cellules de l’hôte.



 uestion
98. Le
fragment duquel biopolymère est présenté à la figure 9 ?
Quelle structure du polymère est présentée (primaire,
secondaire) ? S’il y a des fautes dans la présentation de
ce fragment ?
uestion
98. Le
fragment duquel biopolymère est présenté à la figure 9 ?
Quelle structure du polymère est présentée (primaire,
secondaire) ? S’il y a des fautes dans la présentation de
ce fragment ?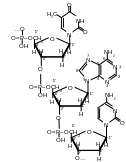 igure
10. Shéma du biopolymère
igure
10. Shéma du biopolymère