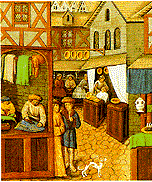- •Теоретичний матеріал Histoire du français
- •Chapitre 1.
- •1. Les origines latines l'expansionnisme linguistique du monde romain.
- •2 . La Gaule romaine
- •2.1 Les peuples soumis
- •2.2 La langue des Gaulois
- •3. Les méthodes romaines de latinisation
- •3.1 Les facteurs de latinisation
- •3.2 Le bilinguisme
- •4. Les grandes invasions germaniques et le morcellement du latin
- •4.1 La victoire des «barbares»
- •4.2 Les suites de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident
- •4.3 Le morcellement du latin
- •Chapitre 2
- •1. La suprématie franque et la germanisation du roman rustique
- •La langue franque
- •1.2 La germanisation du roman rustique
- •2. L'Empire carolingien et la naissance du plus ancien français
- •2.1 Le concile de Tours (813)
- •2.2 Les Serments de Strasbourg (842)
- •2.3 Le traité de Verdun
- •3. Les conséquences linguistiques
- •3.1 La fragmentation linguistique (dialectalisation)
- •3.2 La démarcation du latin au roman
- •3.3 La germanisation du roman
- •4. L'état de la langue romane rustique
- •4.1 Le phonétisme roman
- •4.2 Une grammaire simplifiée
- •4.3 Le vocabulaire
- •Chapitre 3.
- •1. La naissance du français
- •1.1 L'avènement des Capétiens
- •1.2 Le premier «roi de France»
- •1.3 L'expansion du français en Angleterre
- •1.4 La langue du roi de France
- •2. L'état de l'ancien français
- •2.1 Le système phonétique
- •2.2 La grammaire
- •3. Les langues parlées en France
- •4. La dominance culturelle du latin
- •4.1 La langue de prestige
- •4.2 La création des latinismes
- •4.3 Un phénomène ininterrompu
- •1 . L'emploi du français dans les actes officiels
- •2. Les conséquences de la guerre de Cent Ans
- •2.1 L'éviction du français d'Angleterre
- •2.2 La progression du français en France
- •3. L'état du moyen français
- •3.1 Une langue simplifiée
- •3.2 Une langue écrite latinisante
- •1. La prépondérance de l'Italie
- •1.1 Les conflits
- •1.2 Les italianismes
- •2. Les guerres de religion (1562-1598) et le Nouveau Monde
- •2.1 Les conséquences de la Réforme
- •2.2 La découverte du Nouveau Monde
- •3. Le français comme langue officielle?
- •3.1 L'ordonnance de Villers-Cotterêts
- •3.2 L'expansion du français en France
- •4. Les problèmes du français
- •4.1 L'omniprésence des patois
- •4.2 La vogue des latiniseurs et écumeurs de latin
- •4.3 Les défenseurs du français
- •5. Les première descriptions du français
- •Chapitre 6
- •1 Le français s'impose
- •2. Une langue de classe
- •3. Le siècle des «professionnels de la langue»
- •4. L’état de la langue
- •4.1 Le français normalisé : à pas de tortue
- •4.2 Les francisants
- •4.3 Les semi-patoisants
- •4.4 Les patoisants
- •4.5 La Nouvelle-France et les Antilles
- •5. Une langue internationale
- •Chapitre 7
- •1. Un rééquilibrage des forces en présence
- •2. Une civilisation nouvelle
- •3. Le développement du français en France
- •4. L'obstruction de l'école
- •5. L'amorce des changements linguistiques
- •6. La «gallomanie» dans l'Europe aristocratique
- •7. Le début de l'anglomanie
- •Chapitre 8
- •1. La guerre aux «patois» sous la Révolution (1789-1799)
- •1.1 La tour de Babel dialectale
- •1.2 La terreur linguistique
- •2. La langue française
- •2.1 Le calendrier
- •2.2 Les poids et mesures
- •2.3 La toponymie et les prénoms
- •2.4 L'instruction publique
- •3. Les difficultés de la francisation
- •3.1 Un français bourgeois
- •3.2 Vers une langue française nationale
- •4. Le retour au conservatisme sous Napoléon (1799-1815)
- •5. Conservatisme et libéralisme (1815-1870)
- •5.1 Le conservatisme scolaire
- •5.2 La persistance de la diversité linguistique
- •5.3 Le libéralisme littéraire
- •5.4 L’enrichissement du vocabulaire
- •5.5 La récupération politique
- •Chapitre 9 Le français contemporain
- •1. Le rôle de l'Instruction publique dans l'apprentissage du français
- •2. La question de la Charte européenne des langues régionales ou inoritaires
- •2.1 La persistance du discours anti-patois
- •2.2 Les droits des langues régionales
- •3. Les changements contemporains observés
- •3.1 La phonétique
- •3.2 La grammaire et la conjugaison
- •3.3 La féminisation des noms de métiers et professions
- •4. La question de l’orthographe française
- •4.1 La crise des langues
- •4.2 La «réforme» avortée de l'orthographe
- •4.3. Les «rectifications» orthographiques
- •5. La coexistence des usages
- •5.1 Belgique, Suisse et Québec
- •5.2 Les pays créolophones et l'Afrique
- •6. La normalisation et la législation linguistique
- •6.1 La normalisation et les organismes linguistiques
- •6.2 La langue officielle et la loi Toubon
- •6.3 Les autres pays francophones
- •7. Le français dans les organisations internationales
- •7.1 L’Organisation des Nations unies
- •7.2 Les organismes rattachées aux Nations unies
- •7.3 Les grandes organisations internationales indépendantes de l’onu
- •8. L’hégémonie de l’anglais dans les sciences
- •Chapitre 10
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів
- •Самостійна робота з додатковою літературою при написанні рефератів.
- •Thème 5: Le français contemporain .
- •Теми рефератів:
- •Інтернет ресурси:
- •Г лосарій персоналій
- •Grand mariage et mauvais présage
- •C ardinal Richelieu
- •N icolas Sarkozy
3.2 Une langue écrite latinisante
|
|
Si la langue parlée était laissée à elle-même, il n'en fut pas ainsi pour la langue écrite. L'orthographe française demeurait encore très proche du latin, même si linguistiquement le français s'en est considérablement écarté. On peut même parler de «latin francisé». En revanche, il existe peu de textes rédigés en français populaire, mais en voici un exemple trouvé dans le Journal d'un Bourgeois de Paris (de l'année 1416) écrit par un notable membre de l'Université: |
|
|---|---|---|---|
Les pauvres gens mangeaient ce que les pourceaux ne daignaient manger: ils mangeaient trognons de choux sans pain, ni sans cuire, les herbettes de champ sans pain et sans sel. Bref il était si cher temps que peu de ménagers de Paris mangeaient leur soûl de pain; car de chair ne mangeaient-ils point, ni de fèves, ni de pois; que verdure, qui était merveilleusement chère. |
|
||
Les traits les plus marquants du moyen français concernent le lexique et l'orthographe. Le français se répandit de plus en plus en France et gagna des positions réservées naguère au latin, mais celui-ci prit sa revanche en envahissant la langue victorieuse.
Dès le XIIIe siècle, le latin savant faisait son apparition dans le vocabulaire français, mais, au XIVe siècle, ce fut une véritable invasion de latinismes. Au terme de ce siècle, les emprunts au latin devinrent tellement nombreux que les termes français parurent ensevelis sous la masse des latinismes. Un grand nombre de ces mots ne connut qu'une existence éphémère (intellectif; médicinable, suppécliter), mais d'autres réussirent à demeurer (déduction, altercation, incarcération, prémisse). Ce vaste mouvement de latinisation (ou de relatinisation) commença au milieu du XIVe siècle et allait se poursuivre jusqu'au milieu du XVIe siècle. On peut la considérer comme l'un des faits marquants de toute l'histoire du français.
Il faut voir, dans cette période du français, l'influence des clercs et des scribes instruits et puissants dans l'appareil de l'État ainsi que dans la vie économique de la nation. Ces gens, imprégnés de latin, éblouis par les chefs-d'oeuvre de l'Antiquité et désireux de rapprocher la langue parlée, c'est-à-dire celle des «ignorants», de celle représentant tout l'héritage culturel du passé, dédaignèrent les ressources dont disposait alors le français. Si les latiniseurs avaient été formés à la philologie romane, ils auraient sans doute habillé les mots «à la mode romane» (ou vulgaire: «peuple»), mais ce ne fut pas le cas.
Ces «écumeurs de latin», comme on les a appelés, connurent un succès retentissant auprès des grands de ce monde, qui leur prodiguèrent maints encouragements. Ces érudits latiniseurs transcrivirent et/ou traduisirent les textes anciens en les accommodant à l'état du français. Ce faisant, ils éloignèrent la langue française de celle du peuple: ce fut le début de la séparation (ségrégation?) entre la langue écrite et la langue parlée. Le français perdit la prérogative de se développer librement, il devint la chose des lettrés, des poètes et des grammairiens. Voici comment se justifiait un latiniste de l'époque, Nicolas Oresme (v. 1320-1382):
Une science qui est forte, quant est de soy, ne peut pas estre bailliee en termes legiers à entendre, mes y convient souvent user de termes ou de mots propres en la science qui ne sont pas communellement entendus ne cogneus de chascun, mesmement quant elle n’a autrefois esté tractée et exercée en tel langage. Parquoi je doy estre excusé en partie, si je ne parle en ceste matière si proprement, si clarement et si adornéement, qu'il fust mestier. |
Autrement dit, il convient d'user non pas de «termes légers à entendre», mais souvent de «mots propres de la science qui ne soient communément entendus ni connus de chacun». Oresme professait ainsi que plus les termes étaient difficiles et rares, mieux ils convenaient à des écrits savants.
En 1501, à la toute fin du moyen français, un traité anonyme, Le Jardin de Plaisance et fleur de rhetorique, dénonçait déjà cette nouveauté à outrance qui consistait à écumer le latin :
Quint vice est d'innovation De termes trop fort latinisans Ou quant l'on fait corruption D'aucuns termes mal consonants, Trop contrains ou mal resonans Ou sur le latin escumez; Ainsi ilz sont moult dissonans, Indignes d'estre resumez. |
[Le cinquième vice est l'invention de mots nouveaux, trop latinisants, ou quand on corrompt des termes mal consonants, trop forcés ou sonnant mal ou empruntés au latin; c'est ainsi qu'ils sont trop dissonants, indignes d'être repris.] |
En supposant que 20 millions de Français étaient des sujets du roi, on peut penser que quelque 40 000 d'entre eux savaient lire et que le tiers (presque tous les clercs) de cette mince fraction trouvait l'occasion de lire les textes que nous avons aujourd'hui sous la main. On peut estimer que pas plus d'un cinquantième de la population pouvait pratiquer ce français écrit.
Le français s'est développé librement entre les IXe et XIVe siècles, mais le XVe siècle annonce déjà l'époque du «dirigisme linguistique», caractéristique du français qui va suivre. Durant ce temps, en 1452, l'Empire romain d'Orient (Byzance) était envahi par Memeth II, empereur ottoman (avec un seul canon, le premier de l'histoire), et Constantinople devenait Istanbul. La population fut massacrée et les églises, transformées en mosquées.
Питання для самоконтролю:
- En quoi consistait un mouvement de «relâchement linguistique» et du « dirigisme linguistique » au XVe siècle ?
- Quand commence-t-on à utiliser le français comme langue administrative en Occitanie?
- Quels étaient les facteurs qui favorisaient la progression du français en France, mais en limitaient l'expansion en Angleterre au Moyen Age ?
- Quand a-t-on commencé à employer plus ou moins régulièrement le «françois» au lieu du latin dans les actes officiels, dans les parlements régionaux et à la chancellerie royale ?
Chapitre 5
La Renaissance L'affirmation du français (XVIe siècle)
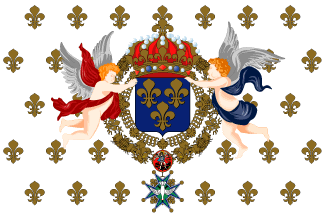
Le XVIe siècle fut celui de la Renaissance. Au plan des idées, en dépit des guerres d'Italie et des guerres de religion qui ravagèrent la France tout au long du siècle, le pays vécut une période d'exaltation sans précédent: le développement de l'imprimerie (inventée au siècle précédent), la fascination pour l'Italie, et l'intérêt pour les textes de l'Antiquité, les nouvelles inventions, la découverte de l'Amérique, etc., ouvrirent une ère de prospérité pour l'aristocratie et la bourgeoisie. Pendant que la monarchie consolidait son pouvoir et que la bourgeoisie s'enrichissait, le peuple croupissait dans la misère et ignorait des fastes de la Renaissance.