
- •Table des Matières
- •INTRODUCTION
- •1.2 Les multiples visages de la biodiversité
- •1.2.2 La biodiversité en tant que ressource alimentaire
- •1.2.3 La biodiversité marchande
- •1.2.4 Les biotechnologies
- •1.2.5 La biodiversité à protéger
- •1.2.6 La biodiversité dont on ne veut pas
- •1.2.7 Biodiversité et société
- •2.1 La classification du vivant et ses principes
- •2.1.4 Écosystèmes
- •2.4 Mesurer la diversité biologique
- •2.5 La distribution géographique de la diversité biologique
- •2.5.1 La diversité taxinomique des milieux aquatiques
- •2.5.2 Les gradients dans la répartition spatiale
- •2.5.4 Une organisation écologique: les biomes
- •2.5.5 Une organisation taxinomique: les régions biogéographiques
- •3.1.2 Le génome
- •3.2.1 Les mécanismes de la spéciation
- •3.2.2 Modes de spéciation
- •3.2.3 Gradualisme et/ou équilibres ponctués
- •3.3 Les extinctions
- •3.5 Quelques grandes étapes dans la diversification du monde vivant
- •3.5.1 Les grandes lignées évolutives et leurs relations
- •3.5.2 Des unicellulaires aux pluricellulaires
- •3.5.4 De la mer à la terre: un passage réussi
- •3.5.5 La longue histoire des vertébrés
- •4.1 Paléoenvironnements et diversité biologique
- •4.1.1 Les systèmes terrestres nord européens
- •4.1.2 Les forêts tropicales humides
- •4.1.3 Les systèmes aquatiques continentaux
- •4.2.1 Le mythe du bon sauvage
- •4.3 Dynamique de la diversité biologique et pressions anthropiques
- •4.3.1 La pression démographique
- •4.3.2 Utilisation des terres et transformation des paysages
- •4.3.4 La surexploitation
- •4.3.6 Les non-dits
- •4.4 Changement climatique
- •5.1 La diversité biologique: un système dynamique
- •5.2 Fonctions des espèces dans les écosystèmes
- •5.2.2 Les organismes ingénieurs
- •5.2.3 Groupes fonctionnels: complémentarité et redondance
- •5.2.4 Le cas des espèces rares
- •5.4 Les relations de voisinage entre espèces
- •5.4.1 La compétition
- •5.4.2 Les relations de coopération: commensalisme et symbiose
- •5.4.3 Le parasitisme
- •5.5 Chaînes et réseaux trophiques
- •5.5.3 Théorie des cascades trophiques
- •5.8 Rôle de la diversité biologique dans les cycles biogéochimiques
- •5.8.2 Minéralisation de la matière organique
- •5.8.3 Stockage à long terme des éléments minéraux
- •5.8.4 Recyclage et transport des éléments nutritifs par les consommateurs
- •5.9 Rôle des communautés biologiques
- •5.9.3 Rôle des communautés des sols
- •6.1.2 Le cas du paludisme
- •6.2 Les pathologies émergentes
- •6.3 Activités humaines, diversité biologique, et santé humaine
- •6.3.1 Les échanges intercontinentaux
- •6.3.2 Les nouvelles technologies liées au mode de vie
- •6.3.4 Les allergies
- •6.4.1 Résistance aux antibiotiques
- •6.4.2 Résistance aux pesticides
- •6.5.1 Les pharmacopées traditionnelles
- •6.5.2 Diversité biologique et industrie pharmaceutique
- •6.5.3 Biotechnologies
- •6.6 Maladies et changements climatiques
- •7.1 La domestication de la Nature: une longue histoire
- •7.4 La révolution biotechnologique et les OGM
- •7.4.1 La transgénèse
- •7.4.2 Les applications dans le domaine agricole
- •7.4.3 Comment prévenir les risques liés aux OGM?
- •7.5.2 La Convention sur la diversité biologique
- •7.5.3 Les catalogues
- •7.6 Brevets sur le vivant: un débat ouvert
- •8.1 Notions de biens et services fournis par les écosystèmes
- •8.2.2 Biens économiques et biens gratuits
- •8.2.3 Appropriation et/ou libre accès à la diversité biologique
- •8.4 Les usages de la diversité biologique
- •8.4.1 Usages alimentaires des ressources vivantes
- •8.4.3 Le bois
- •8.4.4 Les perspectives industrielles des biotechnologies
- •8.4.6 Écotourisme
- •9.2 Approches de la conservation
- •9.2.1 Conservation in situ et ex situ
- •9.3 Les aires protégées
- •9.3.5 Des réserves pour protéger les ressources marines
- •9.4 Une utilisation durable de la diversité biologique
- •9.4.1 Le développement durable
- •9.4.2 Les savoirs traditionnels
- •9.5 La conservation ex situ
- •9.5.1 Les jardins botaniques
- •9.5.2 Les parcs zoologiques
- •9.6 La biologie de la conservation
- •9.6.1 Fragmentation des habitats
- •9.6.3 Écologie de la restauration
- •9.7.1 Santé et/ou intégrité des écosystèmes
- •9.7.2 Les indicateurs biotiques
- •9.8.2 Cyclones et tempêtes
- •9.9 Les conventions internationales
- •9.10.1 Les inventaires patrimoniaux
- •9.10.2 Les protections réglementaires des sites naturels
- •9.10.3 Droit du paysage
- •9.10.4 La maîtrise foncière
- •EN GUISE DE CONCLUSION
- •INDEX

148 6 • Dynamique de la diversité biologique et conséquences (santé)
ou secondaire. Il en résulte que plusieurs agents sont susceptibles de transmettre le paludisme au même endroit, parfois simultanément, parfois à des saisons différentes.
En outre, il existe une grande variabilité intraspécifique pour chacune des espèces. Ainsi, chez A. funestus, certaines populations sont essentiellement anthropophiles, alors que d’autres sont en partie zoophiles, et leurs potentiels de transmission du Plasmodium sont également différents. En ce qui concerne A. gambiae qui est le vecteur principal du paludisme, on sait maintenant qu’il s’agit d’un complexe de 6 espèces jumelles. En outre il existe des espèces cryptiques et des «formes cytologiques» dont la fréquence relative varie en fonction des conditions écologiques et des saisons. La complexité des systèmes génétiques d’A. gambiae est donc extraordinaire. Elle résulte probablement de la capacité de cette espèce à s’adapter rapidement à des environnements qui évoluent, ainsi qu’aux nouveaux habitats créés par l’homme. On comprend ainsi les difficultés rencontrées pour contrôler le paludisme car toutes les espèces ou «formes» n’ont pas toutes les mêmes caractéristiques biologiques et écologiques de telle sorte que les méthodes de lutte doivent être diversifiées.
La complexité réside également dans la variabilité génétique du parasite, Plasmodium falciparum, qui est capable de développer d’importantes variations antigéniques pour échapper à la réponse immunitaire de l’hôte. L’homme se défend en effet en développant une immunité partielle qui se renforce au cours de la vie à mesure que les contaminations s’accumulent. Sans compter que les parasites deviennent actuellement résistants aux produits antipaludéens. La résistance à la nivaquine a été détectée dans les années 1950 et s’est répandue à travers le monde, augmentant ainsi la morbidité due au paludisme. Depuis, des résistances à d’autres antipaludéens sont apparues, obligeant à une recherche permanente de nouveaux produits.
6.2LES PATHOLOGIES ÉMERGENTES
Les infections virales et bactériennes ont longtemps constitué la principale cause de mortalité humaine. La pandémie de grippe qui a sévi entre 1918 et 1919 (la grippe espagnole) a tué entre 20 et 40 millions de personnes, plus que la Première Guerre mondiale. Ce fut probablement l’une des plus grandes catastrophes naturelles ayant frappé l’humanité. Elle a été précédée depuis le début de l’ère chrétienne par de grandes
|
6.2 Les pathologies émergentes |
149 |
|
|
|
||
|
épidémies de peste, maladie animale transmise à l’homme par des |
||
|
piqûres de puces de rongeurs infectés. |
|
|
|
Avec les progrès de l’hygiène et les vaccinations, ce type de mortalité |
||
|
a régressé de manière considérable. On espérait même que la question |
||
|
des maladies infectieuses était résolue. Pourtant, les maladies anciennes |
||
|
réapparaissent et gagnent de nouvelles zones, souvent en raison de |
||
|
l’apparition d’une résistance du pathogène aux traitements thérapeutiques. |
||
|
Ainsi, l’apparition de formes résistantes et la progression de l’urbani- |
||
|
sation ont favorisé le retour de la tuberculose qui a tué 1,7 million de |
||
|
personnes en 2004. C’est le cas également pour le paludisme, la fièvre |
||
|
jaune ou le choléra. |
|
|
|
En plus des maladies infectieuses anciennes, qui restent une cause de |
||
|
mortalité non négligeable, des affections nouvelles, jamais décrites aupa- |
||
|
ravant, apparaissent partout dans le monde et font de très nombreuses |
||
|
victimes. Ces maladies nouvelles sont appelées maladies émergentes. |
||
|
Une trentaine d’entre elles ont été identifiées depuis le début des |
||
|
années 1970. |
|
|
|
|
||
|
Une maladie émergente est une maladie dont l’incidence réelle |
||
|
augmente de manière significative, dans une population donnée, |
||
|
d’une région donnée, par rapport à la situation habituelle de cette |
||
|
maladie. Le concept s’applique à une grande variété de maladies |
||
|
infectieuses, associées ou non à des germes nouveaux. Elles peuvent |
||
|
être d’origine virale, bactérienne ou parasitaire. |
|
|
|
|
||
|
Les animaux jouent un rôle majeur dans l’origine, ou comme vecteur |
||
|
ou réservoir, dans une majorité des maladies virales émergentes. Depuis |
||
délit. |
quelques dizaines d’années, les responsables de la santé ont été confrontés |
||
à l’apparition de fièvres virales hémorragiques (fièvre d’Argentine, |
|||
un |
fièvre du Vénézuéla en Amérique du Sud, fièvre de Lassa en Afrique), |
||
est |
|||
à l’identification de pathologies associées à des germes jamais décrits |
|||
autorisée |
|||
(polyarthrite de la maladie de Lyme, fièvre hémorragique de Malburg). |
|||
|
|||
non |
Un exemple de maladie émergente récente est le syndrome respiratoire |
||
aigu sévère (SRAS) dont l’agent infectieux est un virus de la famille |
|||
photocopie |
|||
des Cornavirus, connu pour ses mutations fréquentes, qui a été trans- |
|||
|
|||
– La |
mis à l’homme par des civettes. L’épidémie apparue au cours de l’hiver |
||
2002-2003 en Asie a provoqué des centaines de décès. Son expansion |
|||
© Dunod |
|||
a été maîtrisée en raison d’une mobilisation sans précédent de tous les |
|||
systèmes sanitaires de la planète. |
|
||

150 6 • Dynamique de la diversité biologique et conséquences (santé)
Chikungunya
Le Chikungunya est une arbovirose transmise par des moustiques du genre Aedes dont les réservoirs de virus sont des primates. Le virus a été isolé pour la première fois en Tanzanie en 1952. Il est responsable d’épidémies observées en Afrique et en Asie. La maladie a récemment fait son apparition en Europe, touchant environ 200 personnes en Italie en septembre 2007. L’épidémie spectaculaire de chikungunya observée en 2005-2006 à la Réunion et à Mayotte, pourrait être due à des souches africaines qui se seraient adaptées à l’homme et au moustique Aedes albopictatus qui n’était pas identifié jusque-là comme vecteur de la maladie. Cependant, on a mis en évidence l’émergence d’un génotype plus virulent en 2005, ce qui expliquerait les nouveaux symptômes graves observés dans les îles de l’océan Indien, alors que la maladie était considérée comme bénigne auparavant.
La plupart des maladies émergentes humaines proviennent de zoonoses, c’est-à-dire du passage naturel de pathogènes de l’animal à l’homme. Il faut pour cela qu’ils franchissent deux étapes.
•L’introduction du pathogène dans un hôte nouveau, l’homme en l’occurrence. Cette phase implique l’existence d’un réservoir chez au moins un animal sauvage et met en jeu des mécanismes de transmission entre l’animal et l’homme, généralement par le biais de vecteurs animaux. Les réservoirs animaux les plus importants sont les rongeurs, ainsi que les arthropodes (insectes, tiques, etc.). On a identifié des centaines de virus chez les arthropodes (arbovirus) dont au moins une centaine peut provoquer des maladies chez l’homme.
L’accroissement de la population mondiale et l’occupation de nouveaux territoires augmentent les probabilités de contact entre l’homme et des espèces vectrices d’organismes pathogènes. De fait, de nombreuses maladies émergentes sont dues à des pathogènes présents de longue date dans l’environnement, au sein de certaines espèces animales, et qui apparaissent soudainement à la faveur d’une transformation de l’environnement. Ainsi, la déforestation en vue de créer des zones de cultures, facilite la multiplication des rongeurs qui servent souvent de réservoirs animaux aux virus. La création de barrages favorise quant à elle la pullulation des moustiques qui sont des vecteurs de nombreux pathogènes. Autant de facteurs qui accroissent les possibilités
6.2 Les pathologies émergentes |
151 |
|
|
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
de contact entre un pathogène et un nouvel hôte tel que l’homme. Il faut y ajouter un phénomène particulièrement important qui est que le transfert accru de ces maladies et de leurs vecteurs à travers le monde.
Certaines maladies émergentes résultent aussi de changements dans nos comportements. C’est le cas de la maladie de Lyme (du nom de la ville de Lyme aux États-Unis). Le pathogène en cause est une bactérie nommée Borrelia burgdorferi. La progression de cette affection est liée à la prolifération des daims dans le nord-est des États-Unis où ils ne sont plus chassés. Ils viennent brouter dans les jardins des maisons situés à proximité des forêts et dépourvus de barrière, Ils amènent avec eux les tiques, porteuses du spirochète, qui piquent l’homme. Il en résulte une augmentation spectaculaire de cette maladie infectieuse dans les régions exposées.
•La dissémination du micro-organisme parmi les populations du nouvel hôte, ce qui implique la mise en jeu de mécanismes adéquats, d’autre part. Les déplacements de population lors de conflits, l’urbanisation, les voyages (des hommes et des vecteurs) sont des facteurs favorables à la dissémination des virus. Le virus du SIDA (ou VIH) a diffusé depuis sa découverte en 1981, de l’Afrique au continent américain puis à l’Europe et à l’Asie. Mais on sait que le virus était présent dès 1970 et s’était déjà répandu en Afrique entre 1970 et 1980. Et l’identification de virus apparentés au virus du SIDA chez des animaux aussi variés que le mouton, le chat, le cheval ou la chèvre indique que la famille VIH est ancienne. Divers singes africains sont naturellement infestés par des rétrovirus proches du VIH mais qui ne provoquent pas de SIDA chez ces animaux. Un des virus humains, le VIH2 est très proche de celui du singe mangabey qui vit en Afrique de l’ouest. Des contaminations à l’homme à partir de morsures ont pu se produire. Quant au VIH1, il aurait pu être transmis par des chimpanzés dont certains sont porteurs d’un virus très proche. Mais on ne sait pas estimer avec précision à quel moment ces virus ont pu franchir la barrière d’espèce. Selon d’autres hypothèses, les hommes sont contaminés depuis longtemps, mais le virus était peu répandu ou peu virulent. L’épidémie actuelle pourrait résulter à la fois d’une évolution de la pathénogénécité du VIH humain et de modifications dans les comportements sociaux qui ont favorisé la diffusion.
Une étude portant sur 335 maladies émergentes entre 1940 à 2004 on a montré que 60% des maladies émergentes proviennent de maladies animales transmissibles à l’homme (zoonoses) et la majorité d’entre elles, d’animaux sauvages. Quelque 20% des maladies émergentes auraient pour origine des résistances aux traitements. Plus de la moitié

152 6 • Dynamique de la diversité biologique et conséquences (santé)
des pathogènes sont des bactéries ou des rickettsies (des parasites présents chez les arthropodes). Les virus ou prions ne sont à l’origine que d’un quart des maladies, le reste étant constitué par des protozoaires, des vers et des champignons. Les maladies émergentes ont quasiment quadruplé durant ces cinquante dernières années, même si la courbe cesse de grimper aujourd’hui. Elles ont connu un pic au cours des années 1980.
Les recherches ont également permis de distinguer deux grandes zones favorables à l’émergence de nouveaux pathogènes pour l’homme. D’une part, les pays tropicaux en développement où une forte pression démographique amène les hommes à côtoyer une faune sauvage très riche et diversifiée. Les zones à risque sont l’Asie du Sud-Est, le souscontinent indien, le delta du Niger et la région des Grands Lacs en Afrique. L’autre grand foyer est constitué par les pays riches où l’utilisation massive des antibiotiques a favorisé l’apparition de souches bactériennes résistantes, le plus connu étant le staphylocoque doré.
Il existe également d’autres causes qui sont liées aux caractéristiques biologiques des pathogènes. C’est ainsi que les virus, compte tenu de leur cycle de vie très court, ont la capacité de s’adapter rapidement aux changements de l’environnement par rapport aux hommes et autres animaux à durée de vie plus longue. L’émergence d’un virus peut ainsi résulter de l’évolution de novo d’un nouveau variant viral, à la suite de mutations ou de recombinaisons entre des virus existants qui peuvent engendrer des souches plus virulentes. Le virus A de la grippe par exemple évolue sans cesse et de nouvelles souches du virus se propagent dans les populations humaines. Les vaccins protègent seulement contre les souches connues et personne ou presque n’est immunisé contre les souches nouvelles. Ne rencontrant aucune résistance, ces dernières se répandent rapidement dans le monde entier et peuvent provoquer de nombreux morts.
On a signalé de nombreux cas de maladies émergentes chez les animaux sauvages. Les causes en sont diverses:
•Le passage de pathogènes d’animaux domestiques à des espèces sauvages vivant à proximité. On peut citer parmi d’autres le passage du Morbillivirus canin (maladie de Carré) au lion qui a provoqué de très fortes mortalités en 1991 dans le parc du Sérenguéti en Afrique. Un autre Morbillivirus a été identifié chez des phoques du lac Baïkal, morts eux aussi en grand nombre. Il est proche également de celui de la maladie de Carré et l’on pense qu’il a été transmis aux phoques par les chiens vivant sur le rivage du lac.
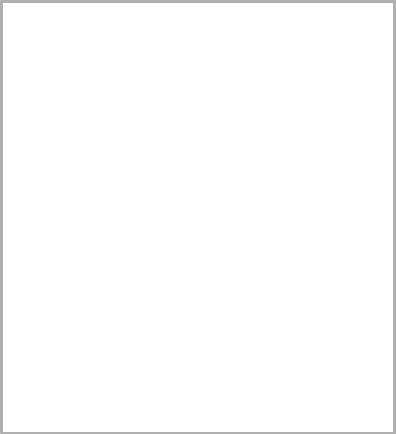
6.2 Les pathologies émergentes |
153 |
|
|
La grippe aviaire
Les «grippes» sont des zoonoses qui affectent de nombreuses espèces animales. La vaste famille des Influenzavirus comprend des virus responsables de la grippe humaine «classique», et différentes souches adaptées chacune à l’infection d’une espèce animale: chevaux, volailles, porc, mammifères marins, etc. Les virus de la grippe évoluent continuellement par mutation. Certains variants sont particulièrement virulents pour l’homme. La pandémie de grippe qui a sévi entre 1918 et 1919 (la grippe dite «espagnole») a tué entre 20 et 40 millions de personnes, plus que la Première Guerre mondiale. Ce fut probablement l’une des plus grandes catastrophes naturelles ayant frappé l’humanité. Depuis on a connu la grippe asiatique en 1957, et la grippe de Hong Kong en 1968.
Le virus de la grippe aviaire H5N1 appartient à la catégorie des virus hautement pathogènes. Il a été repéré pour la première fois chez l’homme en 1997, lors d’une épidémie à Hongkong. Il est réapparu fin 2003, provoquant d’abord des épizooties chez les volailles dans plusieurs pays d’Asie, suivies des premiers cas humains. Dans l’état actuel, le virus ne semble pas capable de se transmettre efficacement d’homme à homme. Mais on peut craindre que le virus de la grippe aviaire et le virus de la grippe humaine infestent simultanément un même hôte, comme le porc par exemple. Auquel cas, des échanges de gènes seraient possibles conduisant à l’apparition de nouveaux agents pathogènes pour l’homme.
délit. |
• Le passage de plus en plus fréquemment observé de pathogènes d’une |
|
espèce sauvage à une autre. Des mortalités massives ont ainsi été |
||
un |
constatées récemment chez des animaux marins tels que les mammi- |
|
est |
||
fères et les coraux, en raison d’une augmentation de la fréquence des |
||
autorisée |
||
épidémies, et de l’apparition de nouvelles maladies. L’origine de |
||
|
||
non |
nombre de ces nouvelles maladies s’explique par le passage d’un |
|
pathogène à un nouvel hôte et non pas par l’apparition de nouveaux |
||
photocopie |
||
pathogènes. Il est probable que les changements climatiques et les |
||
|
||
– La |
activités humaines qui ont accéléré le transport d’espèces dans le |
|
monde ont mis en contact des hôtes avec des pathogènes auxquels |
||
© Dunod |
||
ils n’avaient pas été exposés jusque-là, ce qui expliquerait cette |
||
explosion de nouvelles maladies chez différentes espèces. |
