
- •Table des Matières
- •INTRODUCTION
- •1.2 Les multiples visages de la biodiversité
- •1.2.2 La biodiversité en tant que ressource alimentaire
- •1.2.3 La biodiversité marchande
- •1.2.4 Les biotechnologies
- •1.2.5 La biodiversité à protéger
- •1.2.6 La biodiversité dont on ne veut pas
- •1.2.7 Biodiversité et société
- •2.1 La classification du vivant et ses principes
- •2.1.4 Écosystèmes
- •2.4 Mesurer la diversité biologique
- •2.5 La distribution géographique de la diversité biologique
- •2.5.1 La diversité taxinomique des milieux aquatiques
- •2.5.2 Les gradients dans la répartition spatiale
- •2.5.4 Une organisation écologique: les biomes
- •2.5.5 Une organisation taxinomique: les régions biogéographiques
- •3.1.2 Le génome
- •3.2.1 Les mécanismes de la spéciation
- •3.2.2 Modes de spéciation
- •3.2.3 Gradualisme et/ou équilibres ponctués
- •3.3 Les extinctions
- •3.5 Quelques grandes étapes dans la diversification du monde vivant
- •3.5.1 Les grandes lignées évolutives et leurs relations
- •3.5.2 Des unicellulaires aux pluricellulaires
- •3.5.4 De la mer à la terre: un passage réussi
- •3.5.5 La longue histoire des vertébrés
- •4.1 Paléoenvironnements et diversité biologique
- •4.1.1 Les systèmes terrestres nord européens
- •4.1.2 Les forêts tropicales humides
- •4.1.3 Les systèmes aquatiques continentaux
- •4.2.1 Le mythe du bon sauvage
- •4.3 Dynamique de la diversité biologique et pressions anthropiques
- •4.3.1 La pression démographique
- •4.3.2 Utilisation des terres et transformation des paysages
- •4.3.4 La surexploitation
- •4.3.6 Les non-dits
- •4.4 Changement climatique
- •5.1 La diversité biologique: un système dynamique
- •5.2 Fonctions des espèces dans les écosystèmes
- •5.2.2 Les organismes ingénieurs
- •5.2.3 Groupes fonctionnels: complémentarité et redondance
- •5.2.4 Le cas des espèces rares
- •5.4 Les relations de voisinage entre espèces
- •5.4.1 La compétition
- •5.4.2 Les relations de coopération: commensalisme et symbiose
- •5.4.3 Le parasitisme
- •5.5 Chaînes et réseaux trophiques
- •5.5.3 Théorie des cascades trophiques
- •5.8 Rôle de la diversité biologique dans les cycles biogéochimiques
- •5.8.2 Minéralisation de la matière organique
- •5.8.3 Stockage à long terme des éléments minéraux
- •5.8.4 Recyclage et transport des éléments nutritifs par les consommateurs
- •5.9 Rôle des communautés biologiques
- •5.9.3 Rôle des communautés des sols
- •6.1.2 Le cas du paludisme
- •6.2 Les pathologies émergentes
- •6.3 Activités humaines, diversité biologique, et santé humaine
- •6.3.1 Les échanges intercontinentaux
- •6.3.2 Les nouvelles technologies liées au mode de vie
- •6.3.4 Les allergies
- •6.4.1 Résistance aux antibiotiques
- •6.4.2 Résistance aux pesticides
- •6.5.1 Les pharmacopées traditionnelles
- •6.5.2 Diversité biologique et industrie pharmaceutique
- •6.5.3 Biotechnologies
- •6.6 Maladies et changements climatiques
- •7.1 La domestication de la Nature: une longue histoire
- •7.4 La révolution biotechnologique et les OGM
- •7.4.1 La transgénèse
- •7.4.2 Les applications dans le domaine agricole
- •7.4.3 Comment prévenir les risques liés aux OGM?
- •7.5.2 La Convention sur la diversité biologique
- •7.5.3 Les catalogues
- •7.6 Brevets sur le vivant: un débat ouvert
- •8.1 Notions de biens et services fournis par les écosystèmes
- •8.2.2 Biens économiques et biens gratuits
- •8.2.3 Appropriation et/ou libre accès à la diversité biologique
- •8.4 Les usages de la diversité biologique
- •8.4.1 Usages alimentaires des ressources vivantes
- •8.4.3 Le bois
- •8.4.4 Les perspectives industrielles des biotechnologies
- •8.4.6 Écotourisme
- •9.2 Approches de la conservation
- •9.2.1 Conservation in situ et ex situ
- •9.3 Les aires protégées
- •9.3.5 Des réserves pour protéger les ressources marines
- •9.4 Une utilisation durable de la diversité biologique
- •9.4.1 Le développement durable
- •9.4.2 Les savoirs traditionnels
- •9.5 La conservation ex situ
- •9.5.1 Les jardins botaniques
- •9.5.2 Les parcs zoologiques
- •9.6 La biologie de la conservation
- •9.6.1 Fragmentation des habitats
- •9.6.3 Écologie de la restauration
- •9.7.1 Santé et/ou intégrité des écosystèmes
- •9.7.2 Les indicateurs biotiques
- •9.8.2 Cyclones et tempêtes
- •9.9 Les conventions internationales
- •9.10.1 Les inventaires patrimoniaux
- •9.10.2 Les protections réglementaires des sites naturels
- •9.10.3 Droit du paysage
- •9.10.4 La maîtrise foncière
- •EN GUISE DE CONCLUSION
- •INDEX
4.2 L’homme et l’érosion de la diversité biologique |
91 |
|
|
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
sur les divers groupes animaux et végétaux en fonction des contextes régionaux et locaux.
4.2.1 Le mythe du bon sauvage
Les ethnologues ont en partie accrédité l’idée que les sociétés dites primitives (par rapport aux sociétés industrialisées) qu’ils étudiaient avaient peu d’impacts sur le milieu naturel et qu’elles vivaient en quelque sorte «en équilibre» avec leur environnement. Ce mythe du jardin de l’Éden s’est pérennisé en particulier dans le discours qui s’est développé autour des savoirs traditionnels, relayé par certains mouvements conservationnistes et par une partie du grand public. Pourtant diverses observations tendent à montrer que l’homme moderne n’a fait que prolonger un processus d’érosion de la biodiversité engagé depuis très longtemps par nos lointains ancêtres.
De nombreuses îles du Pacifique furent considérées comme de véritables paradis par les premiers explorateurs, ce qui a contribué au mythe de sociétés primitives en «état d’équilibre» avec leur environnement. Les colonisations successives des îles du Pacifique par l’homme ont entraîné, sans ambiguïté, la disparition de nombreuses espèces de vertébrés. C’est le cas pour les îles Fidji et Tonga il y a 3 500 ans, la Nouvelle-Zélande (3 200 ans) et l’archipel d’Hawaï (2 600 ans). Quant aux Galapagos, elles n’auraient pas été habitées avant l’arrivée des Européens en 1535. On sait maintenant qu’un tiers à la moitié des espèces d’oiseaux qui peuplaient les îles du Pacifique a disparu depuis que l’homme les a colonisées. Cela représente au moins une à deux mille espèces d’oiseaux terrestres (soit 10 à 20% des espèces d’oiseaux connues actuellement) et contredit les premières impressions.
On a montré également que les hommes avaient profondément modifié la végétation. Ainsi la moitié de la forêt de la Nouvelle-Zélande a été détruite par les Maoris entre 800 et 500 ans, pour laisser place à des zones couvertes de fougères ou a des prairies clairsemées. Sur l’île de Pâques, jadis couverte d’une forêt subtropicale luxuriante (cette présence est prouvée par les analyses de pollens fossiles), il ne reste aujourd’hui qu’une prairie appauvrie, et les plus gros animaux autochtones sont des insectes.
4.2.2La disparition des grands mammifères
à la fin du Pléistocène: l’homme est-il en cause?
En dehors des extinctions massives et spectaculaires, des extinctions plus limitées ont eu lieu affectant seulement un ou quelques groupes
92 |
4 • Dynamique de la diversité biologique et activités humaines |
|
|
d’organismes. Ainsi, durant les 50 000 dernières années, sur différents continents et sur plusieurs grandes îles, des centaines de vertébrés terrestres ont disparu sans qu’ils soient remplacés par d’autres espèces. Ces extinctions ont surtout affecté la mégafaune: très peu de petites espèces sont touchées alors que tous les genres de mammifères pesant plus d’une tonne, ainsi que 75% des genres entre 100 kg et 1 tonne disparaissent de la plupart des continents à l’exception de l’Afrique. La question est de savoir si ces extinctions sont le résultat de l’expansion de l’espèce humaine ou si elles ont d’autres causes. De fait, les extinctions n’ont pas eu lieu aux mêmes époques sur tous les continents.
En Australie, colonisée par les Homo sapiens il y a 55 000 ans, tous les mammifères de grande taille ou de taille moyenne ont disparu il y a 50 000 ans environ. Toutes les espèces supérieures à 100 kg et 22 des 38 espèces comprises entre 10 et 100 kg ont disparu, ainsi que trois grands reptiles et l’émeu géant Genyornis qui dépassait 200 kg.
L’Amérique du Nord, il y a 12 000 ans, hébergeait une mégafaune spectaculaire, qui comprenait trois formes d’éléphants, trois formes de guépards, de nombreuses formes d’antilopes, des chameaux, des lamas, des chevaux, des bisons, des tapirs, des loups géants, etc. Il y avait plus de grands animaux qu’il n’y en a actuellement en Afrique. Pourtant, il y a 11 000 ans, presque tous ces grands animaux (70 espèces ou 95% de la mégafaune) ont disparu complètement. C’est l’époque à laquelle l’Amérique du Nord a été colonisée par l’espèce humaine, et pour certains scientifiques, il y aurait des preuves archéologiques que cette extinction serait la conséquence de la chasse. L’Amérique du Sud a également été colonisée par l’homme il y a 11 000 ans et depuis cette époque elle a perdu 80% des genres de grands mammifères.
En Eurasie, la faune de grands mammifères était constituée d’animaux adaptés au froid: rhinocéros laineux, mammouth, ours des cavernes, ainsi que d’animaux adaptés aux périodes tempérées durant lesquelles l’Europe était couverte de forêts: cerfs, daims, sangliers. Cette faune aussi a disparu en grande partie entre – 12 000 et – 10 000 ans.
La situation est différente en Afrique où pourtant l’homme a évolué pendant des millions d’années. La mégafaune est encore bien représentée, même si 50 genres ont disparu il y a environ 40 000 ans. C’est le continent où l’on trouve actuellement la faune la plus diversifiée de grands herbivores dont l’éléphant, l’hippopotame, le rhinocéros, etc., autant de groupes qui étaient représentés abondamment sur d’autres continents avant les extinctions Pléistocène.
La situation est donc paradoxale: en Afrique, là où l’homme existe depuis le plus longtemps, la mégafaune est plus variée que sur les
4.2 L’homme et l’érosion de la diversité biologique |
93 |
|
|
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
continents colonisés par l’homme plus récemment. En réalité, il est difficile avec les informations dont nous disposons d’affirmer (comme certains n’hésitent pas à le faire) que l’homme est responsable de l’extinction de la mégafaune à la fin du Pléistocène. Il est probable qu’un ensemble de facteurs agissant plus ou moins en synergie est à l’origine de la disparition de cette mégafaune sur les différents continents. On pense en particulier:
•aux changements climatiques de la fin du Quaternaire dont les alternances de glaciation et de réchauffement tous les 100 000 ans environ, ont probablement joué un rôle important en modifiant les habitats et en affaiblissant la faune et la flore;
•aux épidémies qui ont pu causer l’extinction d’au moins une partie des espèces, surtout si les hôtes ont été mis en contact avec de nouveaux pathogènes;
•à la chasse qui a pu jouer un rôle, du moins pour certaines espèces et sur certains continents, sachant que le défrichement par le feu, l’introduction d’animaux domestiqués ou commensaux, sont probablement autant d’autres facteurs qui ont pu contribuer à la disparition des grands mammifères.
4.2.3 L’érosion actuelle de la diversité biologique
L’homme moderne possède des moyens techniques inégalés. Il peut faire disparaître certains écosystèmes ou transformer complètement des régions entières. Pour des groupes bien documentés tels que les mammifères et les oiseaux, ou certains groupes végétaux, on peut se baser sur les extinctions documentées d’espèces. On estime ainsi que 108 espèces d’oiseaux et 90 espèces de mammifères se sont éteintes depuis l’an 1600. Il est probable cependant que ce nombre est plus élevé car toutes les régions du monde ne possèdent pas d’archives exploitables. En outre, les effectifs de plusieurs espèces ont atteint à un état critique à l’heure actuelle.
Une grande partie des espèces disparues, que ce soient des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des mollusques terrestres ou des plantes, habitaient des îles. C’est le cas du célèbre dodo de l’île Maurice. Mais des espèces continentales telles que l’auroch, le pigeon migrateur américain ou le grand pingouin, ont également été exterminées par la chasse. Dans le domaine marin on ne compte que deux espèces de mammifères disparues au cours des siècles derniers, même si certaines populations de baleines par exemple, ont connu des périodes critiques.
94 |
4 • Dynamique de la diversité biologique et activités humaines |
|
|
Une ONG, l’UICN (Union internationale pour la conservation de la Nature) a établi des listes rouges d’espèces en péril ou en voie d’extinction. En 2007 on avait recensé 16 306 espèces végétales et animales menacées d’extinction, contre 785 espèces éteintes et 65 ne subsistant qu’en captivité.
En réalité, pour beaucoup de groupes on manque de données fiables sur le nombre d’espèces réellement existantes et sur celles qui sont supposées disparaître. Il est donc difficile dans ce contexte de proposer des informations quantitatives sérieuses en dehors de quelques taxons limités. Il n’est pas question bien entendu de dire que l’homme n’a pas d’impact sur le monde vivant, mais que cet impact n’est peut-être pas le même selon les groupes considérés. Il est évident par contre que certaines déclarations catastrophistes relèvent plus de l’intime conviction, ou du désir de créer un impact médiatique, que de la science…
TABLEAU 4.1 EFFECTIFS DES ESPÈCES AUTOCHTONES ÉTEINTES ET DISPARUES (ET/DISP.),
AUTOCHTONES TOUJOURS PRÉSENTES (AUT.) ET D’ORIGINE EXOTIQUE (EXOT.) EN FRANCE CONTINENTALE ET EN CORSE (D’APRÈS PASCAL et al., 2006).
|
France continentale |
|
Corse |
|
|||
Groupe |
|
|
|
|
|
|
|
Et/disp. |
Aut |
Exot. |
Et/disp. |
Aut. |
Exot. |
||
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Poissons |
2 |
47 |
21 |
0 |
7 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herpétofaune |
1 |
61 |
8 |
1 |
14 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amphibiens |
0 |
30 |
5 |
0 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reptiles |
1 |
31 |
3 |
1 |
8 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oiseaux |
25 |
236 |
37 |
8 |
111 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mammifères |
14 |
88 |
20 |
5 |
26 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
42 |
432 |
86 |
14 |
158 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les évaluations, parfois discutables sur le plan quantitatif, de l’érosion de la diversité biologique, ne prennent pas en compte les phénomènes de spéciation. Or, de même que les espèces évoluent et s’adaptent aux modifications de l’environnement d’origine naturelle (c’est le moteur de la biodiversité), on peut penser également que les espèces évoluent sous l’effet des perturbations d’origine humaine. En introduisant des espèces en divers endroits du monde séparés géographiquement, on crée les conditions pour une évolution allopatrique. Le
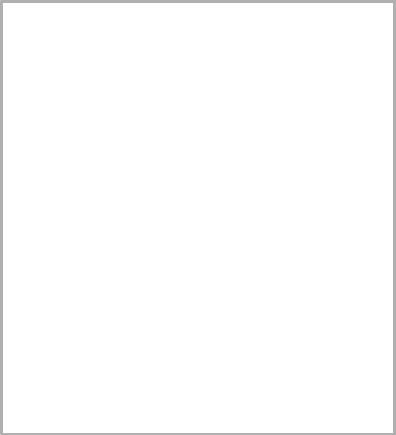
4.2 L’homme et l’érosion de la diversité biologique |
95 |
|
|
temps nécessaire à l’évolution dépend des groupes considérés, mais en réalité on ne connaît pas grand-chose concernant la vitesse de spéciation pour la plupart des groupes.
De toute évidence, pour les micro-organismes, que l’on connaît encore plus mal, la situation n’est pas comparable à celle des vertébrés. Ces micro-organismes évoluent très vite et s’adaptent assez bien aux nouvelles conditions créées par l’homme, comme peuvent en témoigner par exemple les résistances aux antibiotiques, aux pesticides, etc. (voir chapitre 3). On estime que la vitesse d’évolution de certains virus est environ deux millions de fois plus rapide que celle d’un vertébré. Tout porte à croire que l’action de l’homme, en réalité, tend à augmenter la diversité microbienne.
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
Les villes et la diversité biologique
Les villes sont des créations humaines. Les grandes métropoles occupent des zones importantes sur la planète où elles ont remplacé de vastes territoires ruraux. Si la croissance de l’environnement urbain est à l’origine de la disparition de nombreuses espèces, il offre néanmoins de nouvelles opportunités de colonisation pour certaines d’entre elles. La diversité des espèces pourrait même y être plus importante que dans certains habitats ruraux soumis à une agriculture intensive. Certes le fait que les villes se soient étendues récemment, toutes proportions gardées, a laissé peu de temps aux espèces pour évoluer. Mais en adaptant leur comportement, certains colonisateurs ont pu exploiter au mieux les nouvelles conditions qui leur sont offertes: présence de nombreuses structures verticales propices à la colonisation par les plantes et les animaux, environnement climatique plus tempéré, nouvelles sources de nourriture, limitation des prédateurs, etc. Ainsi la population de renards dans le centre de Londres avoisine probablement plusieurs milliers d’individus. Les pigeons ramiers ont trouvé asile en ville où ils ne sont pas chassés, et les tourterelles ont récemment conquis les grandes métropoles à partir des années 1960 en entrant en concurrence avec le pigeon commun et le pigeon des bois. Le transport intercontinental d’espèces est à l’origine d’une diversification de la diversité biologique urbaine: différentes espèces de perroquets ont ainsi élu domicile dans les parcs des capitales européennes, ainsi que divers invertébrés transportés dans les containers.
